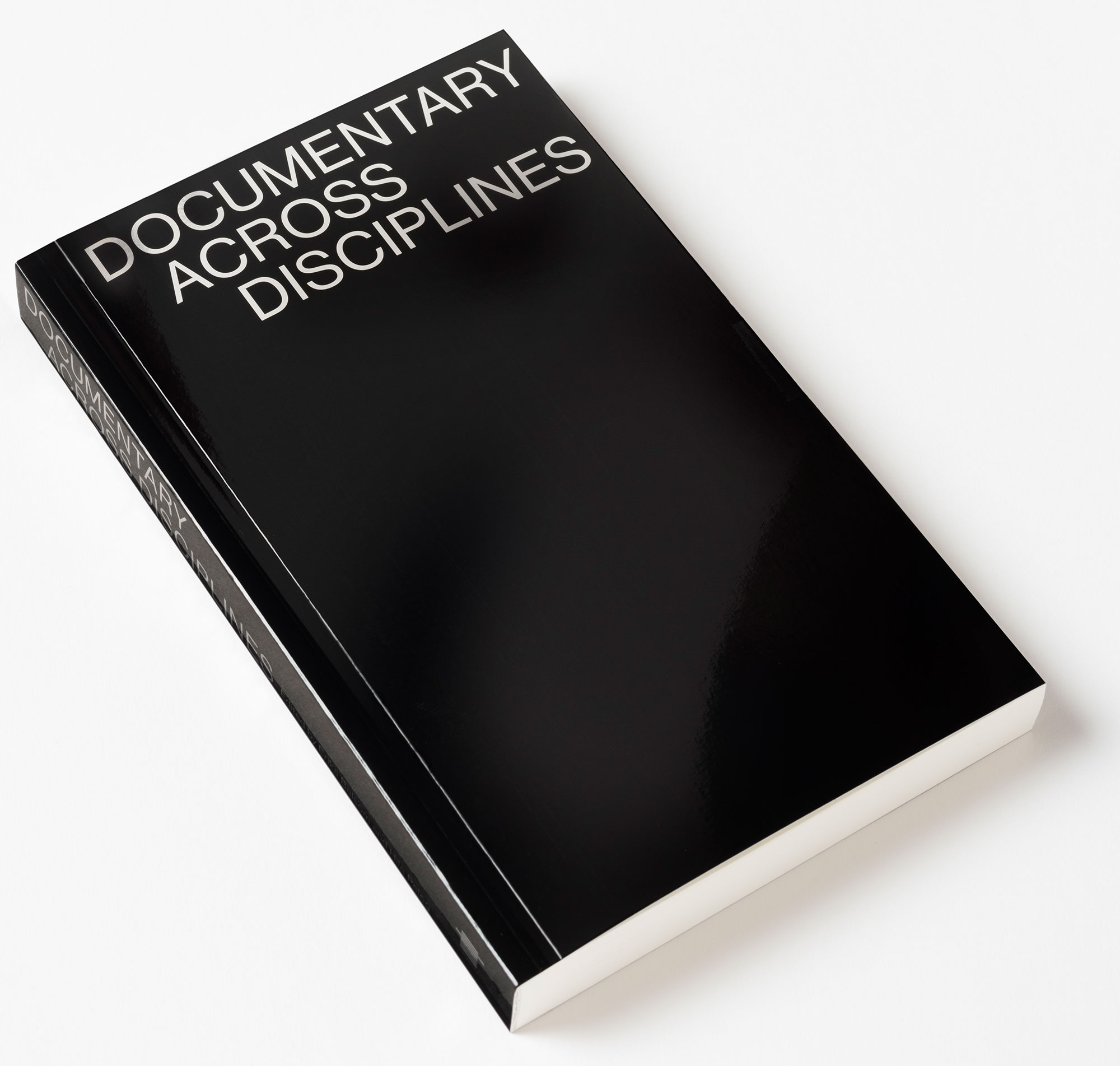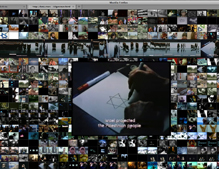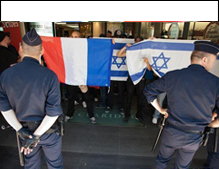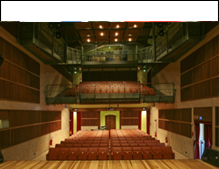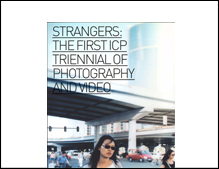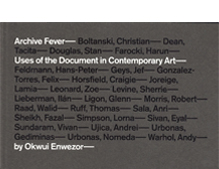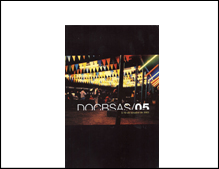-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
Il y a quelques mois, Eyal Sivan, jeune réalisateur israélien de 27 ans, mettait les pieds dans le plat. L’Etat hébreu est-iI un Etat comme les autres ? s’interrogeait-il dans Izkor, un film sur l’étouffant système d’éducation de son pays, trop axé, selon lui, sur le culte de la souffrance du peuple juif. Ce nationalisme, démontrait-iI, rend les Israéliens “esclaves de la mémoire”, et meilleurs soldats que bons citoyens. Quelques jours après le début de la guerre du Golfe, il se précipite en Israël. A dix kilomètres de Tel-Aviv, il tombe, en pleine guerre, sur la construction d’un Luna Park : Israland... Métaphore d’Israël, ce chantier lui permet de filmer une galerie de portraits qui témoignent de la complexité locale. Les frontières Invisibles, forgées par la peur et la haine de l’autre, qui verrouillent ce pays, séparent aussi les ouvriers arabes et israéliens. Ils travaillent ensemble, mais se méfient au point de se tourner le dos et de ne jamais s’adresser la parole. Au milieu d’eux, Gershom, l’architecte, un Allemand converti au judaïsme, multiplie, amusé et dupe de rien, les notations symboliques. Et Abraham, le promoteur fortuné qui pense apporter sa pierre à l’histoire d’Israël et gagner ainsi le paradis (Le 15 juillet dernier, il se donnait la mort dans son bureau. Une balle en pleine tête). Débarrassé de la lourdeur et de la longueur d’Izkor, Eyal Sivan a réussi, cette fois, un film drôle, qui montre avec légèreté la grave et explosive réalité d’Israël. Un conte philosophique aux allures de fable surréaliste.
Jean-Claude Raspiengeas
*
A Jérusalem, un réalisateur israélien a présenté son film clandestinement à des Palestiniens. Amorce de dialogue
Au pied du mur
Jésuralem-Est. Au-dessus de la porte de Damas, point de passage principal pour la vieille ville, dans le contre-jour de la meurtrière, une silhouette en armes domine la place. Un soldat, symbole visible, immédiat, de l’annexion israélienne. Un peu plus bas, d’autres soldats contrôlent, fouillent, filtrent.
A deux pas de là, la rue Salah el Din, les anciens Champs-Elysées de Jérusalem, est déserte. Atmosphère sinistre. Comme tous les jours à 13 h, les commerçants arabes ont appliqué le mot d’ordre de grève générale de l’Intifada. Les rideaux baissés sont couverts de graffitis hostiles qu’une patrouille israélienne vient de recouvrir de croix noires, de chandeliers et d’étoiles de David. Au lance-flammes.
Au numéro 21, le Centre culturel français. Au milieu du jardin, havre de paix dans cette partie de la ville où le feu couve en permanence sous les cendres. Eyal Sivan, jeune réalisateur israélien de 27 ans, discute ce jour-là avec Myriam, une Palestinienne de son âge, un foulard sur la tête. “Je suis né à Haïfa, lui dit-il. Et la Palestine est aussi ma terre. Je suis un problème pour toi, palestinienne. Haïfa m’appartient autant qu’à toi. Je suis pour l’autodétermination des Palestiniens, pour le retour de tous les Palestiniens sur leur terre, pour leur droit à un Etat indépendant. Mais je tiens aussi à mon autodétermination. Alors, que feriez-vous de moi dans votre futur Etat, même en supposant qu’il soit celui de tous ses citoyens, démocratique et laïc ?
Tu as tué mon père et mon oncle.
Pas moi. J’ai refusé de faire mon service militaire dans cette armée d’occupation.
Tu appartiens à un peuple qui nous a écrasés. Nous ne l’oublierons jamais. Jamais !
Attends. Tu as face à toi l’Israélien le plus progressiste que tu rencontreras jamais ! Mes ennemis ne sont ni les Israéliens, ni les Palestiniens, mais tous ceux qui pensent que la solution, c’est la guerre.
Moi, répond Myriam, je ne veux pas vivre avec des Israéliens qui ne m’ont jamais ni comprise, ni acceptée.
Tu ne vois donc pas que la seule guerre que pourraient gagner les Palestiniens, c’est celle de la paix ? Vous voulez la guerre. Les Israéliens n’attendent que ça et, à ce jeu-là, Tsahal gagnera toujours. Tu le sais bien.” Elle le sait. L’Intifada s’essouffle depuis plusieurs mois. Les commandements locaux manquent d’idées et ne contrôlent plus les troupes d’adolescents désœuvrés qui ont basculé dans un spontanéisme désespéré. Elle le sait, mais ne veut pas reculer. Il y a désormais trop de morts entre les mots.
Israël étouffe. Tout le monde rêve d’ouvrir sa fenêtre et de parler à son voisin. Mais l’ignorance de l’Autre tétanise les meilleures volontés. Les uns se planquent derrière les mots d’ordre de l’OLP ; les autres respectent l’intransigeance de leur gouvernement. Les Scuds qui violaient le ciel, l’hiver dernier, ont rajouté des barreaux aux regards. Israël, pays aux limites géographiques toujours incertaines et contestées, est quadrillé par des frontières invisibles et mouvantes dont la peur, jour après jour, redessine les contours. Peur de l’armée, peur des poignards, peur des pierres. Tout le monde y pense.
Quelques heures plus tard, nous sommes sur la route de Ramallah, à 17 kilomètres de Jérusalem, dans les territoires occupés. Le couvre-feu est tombé depuis une heure. Keffieh sur le tableau de bord, plafonnier allumé, vitres relevées, appels de phares répétés, chacun guette la moindre ombre derrière les murs, la pierre qui va trouer l’obscurité et faire éclater le pare-brise. Ce soir-là, aux check-points, les barrages sont levés. Pas de contrôles. Eyal Sivan va montrer ses films (Izkor Esclaves de la mémoire et Israland) aux Palestiniens. Eric Auzoux, le très actif directeur du Centre culturel français qui a monté l’opération, se félicite : “C’est la première fois qu’un réalisateur israélien présente ses films dans les territoires.” Les invitations ont circulé clandestinement. Une trentaine de Palestiniens sont déjà là, dans une salle de projection improvisée. Dans celle ville sinistrée, dévastée, ils ont bravé le couvre-feu pour passer la soirée avec un cinéaste israélien, alors qu’ils ne sortent plus, même pour aller chez des amis. L’armée israélienne qui patrouille dans les rues peut intervenir n’importe quand et arrêter tout le monde. “Comment dialoguer, demande un Palestinien, lorsque l’un des deux interlocuteurs est à terre avec le pied de l’autre sur le ventre ?”
Islah, égérie locale, raconte, le regard las, la vie quotidienne soumise à l’arbitraire de la loi militaire. “Ils ont détruit notre ville. Tous nos déplacements sont soumis à autorisation. Ils emprisonnent et déportent sans motif. Malheur à celui qui est surpris, seul, la nuit dans la rue. Au mieux, ils le tabassent, l’humilient. Des milliers de prisonniers croupissent ainsi sans procès. Ils tirent pour tuer. Un blessé par balle ne doit pas être opéré avant que les médecins (des fonctionnaires) aient prévenu les autorités militaires. Toutes les familles comptent un blessé, un prisonnier ou un mort. Il n’y a plus de vie culturelle. Depuis trois ans, les universités palestiniennes sont fermées, les écoles l’ont été pendant un an et demi. Mes enfants de 9 et 14 ans sont dans la rue. Devant eux, c’est le vide. Les Israéliens nous confisquent les terres. Même si la justice nous donne raison, on ne peut pas les récupérer. Et nous sommes obligés de payer le bulldozer qui rase nos maisons.”
Jeeps de l’armée qui sillonnent les routes, militaires armés prêts à sauter, camps surpeuplés entourés de barbelés, longues files d’attente sous le soleil pour la mise à jour des papiers d’identité. Les images remontent. A chaque carrefour important, sur le toit des immeubles, une tente, le drapeau israélien, et toujours l’impassible militaire assis, mitraillette alignée. Présence hostile, menace permanente... “Mais vous savez, dit l’un des Palestiniens, la peur est encore la meilleure des patrouilles d’occupation.”
Eyal Sivan, qui vit en France depuis six ans, agace ses compatriotes, d’autant qu’il critique son pays de l’extérieur. Il dénonce le nationalisme israélien, le système éducatif porte-parole d’une idéologie centrée autour de la Shoah, le sionisme comme instrument de domination. A la fin de la projection, les Palestiniens mettent du temps à réagir. Ils sont comme assommés. Eux qui utilisent souvent une rhétorique de victimes découvrent un regard israélien sans complaisance et mesurent à quel point “la force” d’Israël s’est structurée sur la mémoire de ses souffrances. Ils se sentent désarmés. Eyal Sivan les prend à contre-pied : “Sur quoi allez-vous fonder votre Etat ? A quand cette liberté de ton dans vos rangs ?” Ils ont du mal à répondre. “C’est logique, commente plus tard Eric Auzoux qui milite activement pour le dialogue. Depuis trois ans, les Palestiniens ne voient que des colons ou des soldats. Ils n’ont plus aucun contact normal avec la société. Ils se perçoivent comme à l’intérieur d’un immense camp de réfugiés.”
“Les Palestiniens, témoigne Marius Schattner, correspondant de l’AFP, auteur d’une remarquable Histoire de la droite israélienne (1), sont prêts à n’importe quelle croisade contre Israël. Ils sont à la remorque de n’importe quel leader arabe. Il faut reconnaître aussi que c’est compliqué pour eux : il n’y a pas un seul modèle de société arabe désirable.”
Dans tous les propos, la jubilation éprouvée à voir tomber les Scuds irakiens est intacte, avec le désir avoué que le dictateur de Bagdad recommence. La guerre est perdue. Saddam Hussein, discrédité. Pourquoi s’entêter à se ranger derrière lui ? Les Israéliens ont une réponse. Ils raffolent de ce mot prêté à Abba Eban, leur ancien chef de la diplomatie : “Les Palestiniens ne ratent jamais une occasion de rater une occasion...” Les rares Israéliens qui avaient des amis palestiniens ont depuis cessé de les voir. “L’Intifada a déstructuré la famille palestinienne traditionnelle, explique Abdel Salam, un jeune professeur palestinien de Jérusalem. Chez nous, le père est écouté et obéi religieusement. Aujourd’hui, les gosses de l’Intifada ne respectent plus cette loi et imposent la leur. Ils font n’importe quoi. Les deux peuples ont envie de se parler. Nous sommes des sentimentaux. Si les Israéliens font un pas, nous en ferons dix.” Ambiguïté du discours palestinien, un peu plus tard, il lâche : “Si le dialogue s’engage, il faudra relancer l’Intifada pour s’affirmer avec force.”
Depuis décembre 1987, le bilan est terrible et accablant : 830 Palestiniens tués par l’armée israélienne, 355 exécutés par les Palestiniens eux-mêmes pour faits de collaboration. Au-delà de cette tragique hécatombe, l’Intifada use ce peuple, économiquement exsangue. L’arrivée récente de trois cent mille juifs soviétiques est vécue comme une catastrophe, “On a du mal à prendre aux sérieux les discours sur les droits de l’homme à leur sujet”, s’insurge Islah.
La résistance palestinienne de l’intérieur agit aussi comme un virus au sein même de l’armée israélienne. Comparée aux guerres héroïques de 1948, de 1967 et de 1973, la répression dans les territoires occupés provoque un sérieux malaise, “Que raconterons-nous à nos enfants ? ruminent parfois les militaires. Nous n’avons pas combattu des soldats ou des terroristes, mais abattu des gosses...” Quatre cents soldats ont déjà refusé de servir dans les territoires, préférant la prison à cette répression aveugle. Leur maître à penser est un vieux philosophe, religieux orthodoxe, sioniste convaincu, le professeur Yeshayahou Leibovitz, véritable poil à gratter de la conscience israélienne. Dans son bureau, qui croule sous les grimoires et les vieux livres, cassé en deux, il martèle ses convictions : “Le conflit israélo-palestinien est la conséquence d’une longue histoire qu’on ne peut pas corriger. L’un des deux peuples domine par la force le pays tout entier et enlève à l’autre toute possibilité d’indépendance. Victoire militaire écrasante, la guerre des Six Jours, en 1967, a été un désastre politique qui a transformé l’Etat israélien en instrument de domination violente sur un autre peuple. Cette situation ne peut être maintenue que par la violence. La terreur devient donc inévitable. A l’intérieur, l’Etat d’Israël risque de devenir un Etat fasciste. A l’extérieur, cette guerre à outrance risque de nous faire commettre la même erreur que les Arabes, il y a quatre ans. Ils ne comprirent pas qu’en s’opposant à la création de l’Etat d’Israël, ils luttaient contre le monde entier. Ce fut leur folie. C’est aujourd’hui la nôtre. Nous ne comprenons pas que nous luttons contre le monde entier. Le monde entier est aujourd’hui du côté des Arabes. Si cela devait se prolonger, l’Etat d’Israël irait vers sa destruction. Il reste l’idée du partage, naturellement. C’est la seule solution. Elle est douloureuse pour la conscience de chaque peuple mais, elle aussi, inévitable. Certes, l’OLP a versé dans le terrorisme, mais l’Etat israélien a assassiné cent cinquante enfants en deux ans et élevé des camps de concentration pour les Palestiniens, il manque à ce pays un De Gaulle. Si nous voulons éviter une catastrophe historique, nous n’avons plus le choix. A condition aussi que les Palestiniens renoncent à détenir toute la Palestine. Franz Grillparzer dénonçait déjà au XIXe siècle le chemin qui mène "de l’humanité à la bestialité en passant par le nationalisme".”
Son fils spirituel, Eyal Sivan, tire, lui aussi, la sonnette d’alarme : “L’Etat d’Israël est en train d’anéantir le judaïsme, culture et religion, en le convertissant en communauté nationaliste. II détruit le juif en le transformant de force en sioniste borné. Alors que tous les Etats idéologiques s’effondrent. L’Etat d’Israël, au contraire, se renforce. Je pense toujours à ce magnifique proverbe arabe : "0n peut réveiller celui qui dort, mais il est impossible de réveiller celui qui fait semblant de dormir".”
“Ce qui nous manque, pense Renée Sivan, la mère d’Eyal, c’est un roi Salomon qui, d’un geste, sache départager les raisons de ces deux peuples.”
De notre envoyé spécial en Israël, Jean-Claude Raspiengeas.