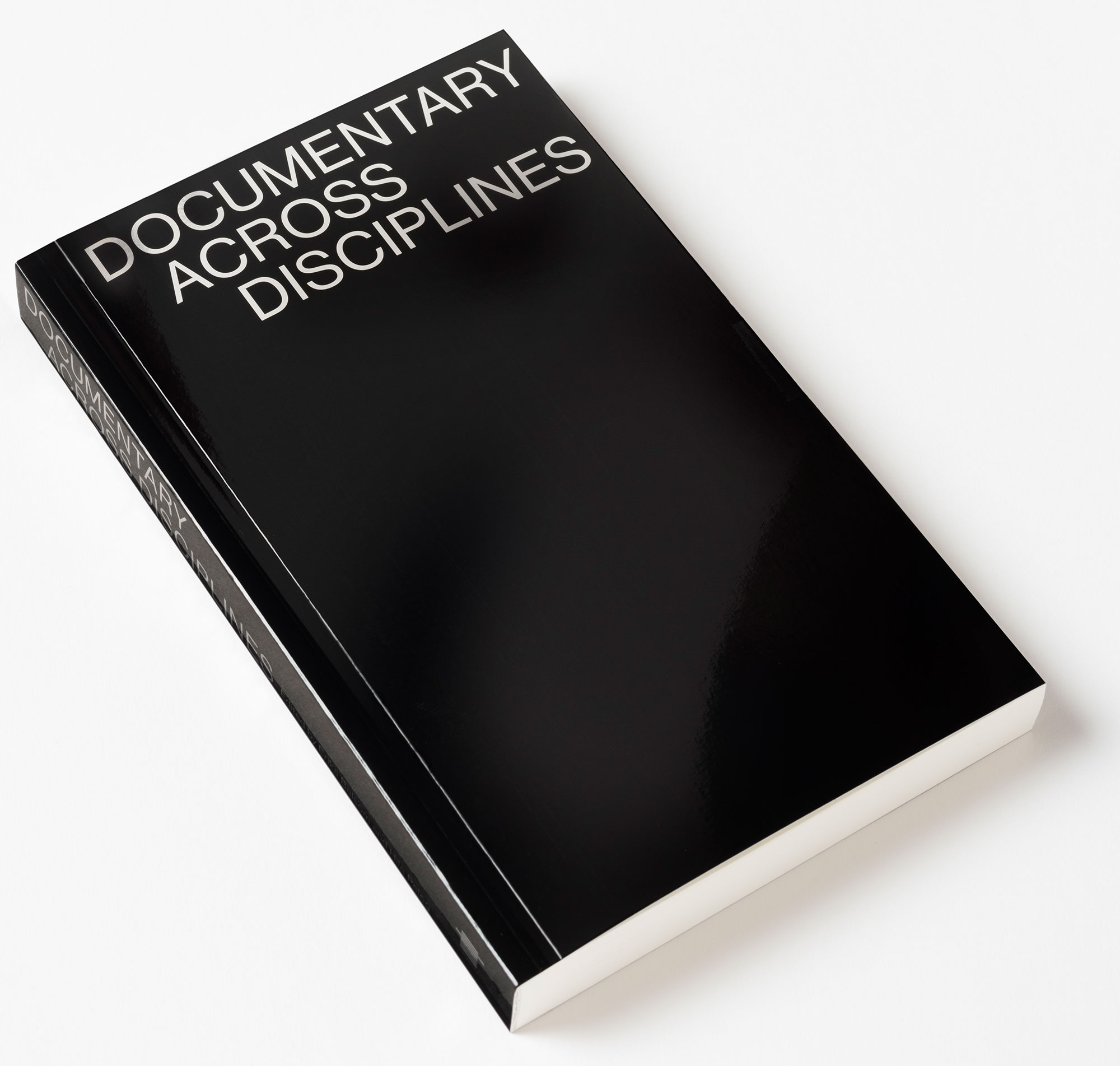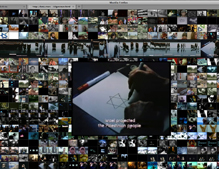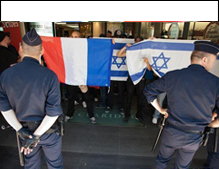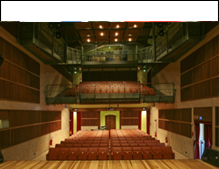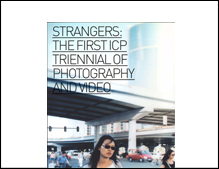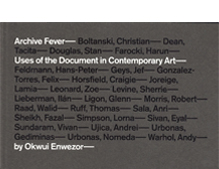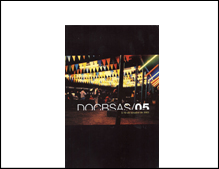-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
Eyal Sivan est cinéaste. Il a réalisé notamment "Izkor, les esclaves de la mémoire" (1991) et de "Route 181, fragments d’un voyage en Palestine-Israël" (co-réalisé avec Michel Khleifi et sorti en 2003).
Comment analyses-tu l’état de la société israélienne après son échec récent au Liban ? Comment les transformations qui se sont produites dans cette société et les conséquences de la guerre peuvent-elles - et, de ton point de vue, devraient-elles - être intégrées dans la réflexion sur les stratégies de lutte contre l’occupation ? Parallèlement, quelles sont les leçons que le mouvement de soutien aux Palestiniens devrait tirer de son échec à élargir la base du soutien aux Palestiniens et aux Libanais ? Et comment, enfin, devons-nous comprendre et agir sur notre échec persistant à infléchir le soutien de nos gouvernements à la politique meurtrière, destructrice et auto-destructrice d’Israël ?
Dans le camp anticolonial israélien, ce que l’on appelle la « gauche radicale », certains font une analyse qui consiste à dire : “si ça continue comme ça, Israël va à sa perte”. Le problème c’est que, dans cette analyse comme dans presque toutes les autres, on ne fait pas la distinction entre Israël et les Israéliens. Israël, c’est une idée, un concept. Les Israéliens, c’est des citoyens parmi lesquels une grande majorité n’a pas choisi de faire partie de l’Etat colonial israélien. Toute action qui a comme but de changer la situation israélienne, c’est-à-dire d’abolir la structure coloniale sioniste, est paradoxalement une action qui tend à protéger Israël de la destruction vers laquelle elle s’engage inexorablement. Le paradoxe dans lequel se trouve tout le mouvement de contestation radicale, en Israël comme ailleurs, réside dans le fait de considérer que toute action qui tend à changer la situation, face à ce danger qui vient d’Israël lui-même, est quelque chose qui peut sauver Israël de la destruction vers laquelle il va la tête la première. Sortir de ce paradoxe nécessite une attitude inverse, comme celle que propose notamment l’historien israélien Amnon Raz-Krakotzkin, qui dit que la seule ligne sérieuse est celle qui consiste, pour les Palestiniens notamment, à faire des propositions et à s’adresser non à Israël, mais bien aux Israéliens. Je vais y revenir.
Nous sommes quelques-uns à réfléchir sérieusement à la question des sanctions - notion qui, soit dit en passant, est à l’opposé de celle de boycott. Comment penser les sanctions : respect du droit international, bien sûr, mais au nom de quoi ? Au nom du droit lui-même ? Ça ne suffit pas. Du point de vue occidental, l’Europe doit au minimum être en phase avec les exigences qu’elle a elle-même formulées : deuxième paragraphe de l’Accord d’association assujetti au respect des droits de l’homme, 4ème convention de Genève, droit humanitaire international. Ces seules clauses, qui figurent dans l’Accord d’association signé entre Israël et l’Union européenne, suffiraient à motiver des sanction à partir d’une perspective européenne. Ensuite, il y a deux attitudes possibles : la première, c’est celle qui consiste à dire qu’il s’agit de protéger le peuple palestinien, d’obtenir l’arrêt des exactions, etc. On considère alors que l’application des sanctions et l’exigence du respect du droit international sont dirigées contre Israël. Cette attitude tombe alors sous la dialectique qui consiste à utiliser le droit international et l’esprit européen pour attaquer Israël. C’est évidemment une attitude possible, utiliser les sanctions contre Israël, pour protéger les Palestiniens. La deuxième possibilité, c’est un changement de discours : ce ne sont pas des sanctions contre, ce sont des sanctions pour : pour sauver les Israéliens, pour permettre un avenir, pour ouvrir une possibilité d’existence.
Prenons l’Afrique du Sud, qui est un cas à bien des égards comparable. À l’époque de l’apartheid, il existait une vision post-coloniale qui prenait en compte les colons. Ce n’est pas du tout le cas d’une autre situation que nous connaissons bien, celle de l’Algérie. En Algérie, l’avenir des colons n’était pas pris en considération par le camp anticolonial. Or c’est là que réside le blocage aujourd’hui dans l’attitude vis-à-vis d’Israël. Bien sûr, nous sommes dans une situation coloniale. Mais il n’y a pas d’issue si l’on n’a pas une attitude d’inclusion à l’égard des « colons » - et je donne là au mot « colons » son sens le plus large, qui ne se réduit pas à la population des colonies de Cisjordanie, mais regroupe en fait l’ensemble de la population issue de la colonisation sioniste.
« Israël » est une notion biblique qui renvoie à la notion de peuple juif. Ce qui est terrible, et en même temps c’est véritablement du Fanon, c’est que c’est aux colonisés, aux opprimés d’offrir quelque chose aux colons. Si nous respectons le droit des peuples et si nous sommes solidaires de tous les peuples en tant que peuples, nous devons répondre à la question de savoir quels sont les droits que nous reconnaissons au peuple israélien. Alors que l’Occident parle en termes de droits d’Israël, de droit à l’existence, de droit à se défendre, droit à l’existence d’un Etat juif, etc., c’est là qu’il faut poser la question, et si possible y répondre, des droits du peuple israélien, donc la question de son droit national en tant que peuple israélien et non plus en tant qu’Etat d’Israël.
Aujourd’hui, la société israélienne est mûre au plan social, économique, militaire, pour accepter la distinction entre peuple et État. C’est là, aujourd’hui, que réside la contestation contre la guerre. Les manifestations des familles qui ont perdu des fils dans cette guerre augmentent tous les jours devant la Knesset et vont peut-être aboutir à la dissolution du gouvernement. C’est le syndrome de 73. Des gens dorment devant la Knesset en demandant la démission d’Olmert comme à l’époque ils demandaient, et ont obtenu, la démission de Golda Meïr. Or à cette époque, le slogan de Moti Ashkenazi, qui était à la tête de ce mouvement, c’était « L’Etat, c’est toi et moi ». C’était une remise en cause radicale de l’Etat sioniste et de sa prétention à incarner le peuple. Aujourd’hui, la contestation porte sur la structure du pouvoir et sur l’échec de ce pouvoir à assurer le bien-être d’un côté, la sécurité de l’autre. On se retrouve ainsi dans une configuration identique à celle de la fin du dernier gouvernement Sharon, qui a vu les pauvres se dresser contre l’Etat. Dans le quotidien israélien Yediot Aharonot du 22 août 2006, Ron Ben Yishaï analyse la supériorité tactique dont a fait preuve le Hezbollah dans cette guerre. Il conclut dans ces termes : « Ce dont nous [Israéliens, Ndlr] avons besoin est un engagement total de l’Etat d’Israël, à la fois en termes financiers et mentaux, de sorte que l’armée israélienne développe et mette en place rapidement des méthodes d’opérations de combats, des moyens uniques de combat et des capacités de renseignement tactique efficaces, garantissant des résultats différents lors du prochain round. » Tu as réalisé en 1990 un film, intitulé Izkor, les esclaves de la mémoire, consacré à étudier les procédures complexes de l’endoctrinement idéologique en Israël. Tu connais donc peut-être mieux que quiconque les performances dont est capable le système israélien dans ce domaine. Tu me faisais part récemment de ton optimisme quant au fait que les Israéliens allaient enfin comprendre qu’ils ne pouvaient pas compter sur leur armée pour vivre en sécurité. Le penses-tu vraiment, le penses-tu toujours à la lecture de cet article, comme d’autres du même tonneau ?
Plusieurs commentateurs israéliens parlent de l’américanisation de l’armée israélienne. Ben Yishaï dit : face à des méthodes de guérilla, il faut transformer la société israélienne, sur le plan idéologique et militaire, en une société de guérilla. Mais si cette guerre a été perdue, c’est bien parce que s’est perdue, dans la société israélienne, cette disposition à mourir. Le syndrome de Massada, qui est toujours actif idéologiquement et politiquement, s’est affaibli socialement. C’est l’une des conséquences de l’américanisation de la société israélienne : son aptitude au sacrifice se réduit en permanence. Or il reste deux bastions dans lesquels cette disposition perdure, et ces deux bastions sont eux aussi des miroirs de l’américanité : il y a d’un côté les colons des territoires de 67, on peut parler d’idéologie du sacrifice, et un parallèle est possible avec les évangélistes protestants de la droite américaine ; et de l’autre, il y a les gens des périphéries, les Hispaniques et les Noirs en Amérique, les juifs arabes en Israël : pour eux, l’armée reste un milieu intégrateur. Les unités de commando créées par Barak à l’époque de la première Intifada offrent aujourd’hui une possibilité d’ascension sociale. À l’époque, Barak, issu de l’unité d’élite Sayeret matkal et chef d’Etat-major, a fondé de petites unités mobiles de renseignement d’un côté, des escadrons de la mort de l’autre, qui intégraient des soldats ressemblant à des arabes pour s’infiltrer dans la population palestinienne. Ce fut une mutation des unités de commando spéciales jusqu’alors réservées à l’élite ashkénaze des kibboutz et des grandes écoles. C’est pour les juifs arabes une possibilité d’ascension sociale par intégration dans les commandos spéciaux. [En Israël, l’itinéraire militaire individuel est déterminant pour le parcours social ultérieur. Ndlr]. C’est un phénomène que l’on peut comparer à la présence massive de Noirs dans les unités spéciales américaines. Voilà donc les deux bastions sociaux de Massada : le risque que sont prêts à prendre les colons d’un côté, les mizrahim de l’autre. Sinon, la société a perdu sa capacité à encaisser. La dernière guerre s’est appuyée sur l’idée d’un « arrière fort », un front domestique capable d’encaisser les roquettes qui tombaient. Mais à la lettre, la société israélienne ne peut plus, ne veut plus encaisser. D’où la colère actuelle. En plus, ni les Américains ni les Européens ne peuvent plus compter sur les Israéliens comme avant. Il ne faut pas oublier qu’Israël avait déjà commencé à perdre avant le début de la guerre du Liban : par son échec à arrêter les Qassam en provenance de la bande de Gaza, en dépit des destructions, des morts, et malgré sa politique unilatérale, son désengagement. C’est pour la société israélienne l’indication que l’Etat est incapable de défendre la population civile israélienne. C’est d’ailleurs aussi, pour l’Occident l’indication qu’Israël ne réussit plus à faire ce qu’on attend de lui.
C’est peut-être une bonne nouvelle ?
Non. Il y a ceux qui disent : “tout va mal donc tout va bien. Il n’y a qu’à laisser faire, et Israël ira dans le mur tout seul”. Le problème, outre la question des principes, c’est que si le syndrome de Massada est en déclin, le syndrome Samson est encore très actif. C’est le syndrome qui consiste à dire : « Je mourrai avec les Philistins ». À entraîner autant de monde possible dans sa chute. Et il ne fait pas de doute qu’Israel a cette capacité. N’oublions pas que le nom de code de l’arme nucléaire, c’est « l’option Samson ». Mais c’est une vision un peu apocalyptique, par quelque bout qu’on la prenne. Revenons à la question des principes : si nous avons une attitude de respect du droit des peuples et si nous sommes solidaires de tous les peuples en tant que peuples, nous devons répondre à la question des droits du peuple israélien. Un sentiment très fort aujourd’hui, et qui n’a pas encore de traduction politique, c’est le sentiment du doute quant au pouvoir même de l’Etat ; pas la question de savoir quel pouvoir est en place, mais l’idée que le problème, c’est précisément le pouvoir, la structure du pouvoir, le pouvoir sioniste. Pourquoi ce sentiment n’a-t-il pas encore de traduction politique ? Parce qu’il n’y a pas encore d’alternative à l’idéologie, au mode de gestion et au mode de pouvoir sioniste. Personne n’a encore proposé d’alternative capable d’émerger. La raison en est qu’il n’y a que deux alternatives possibles au sionisme. Premièrement, l’alternative ashkénaze de la classe moyenne, consistant à prendre un deuxième passeport, de préférence européen - polonais, tchèque, allemand, autrichien, hollandais. C’est un véritable phénomène de société qui se vérifie très concrètement dans la presse : en Israël, les cabinets d’avocats ont le droit de faire de la publicité, et l’on constate une explosion des annonces offrant des arrangements pour obtenir une citoyenneté européenne. Ça, c’est l’alternative qui s’offre aux Ashkénazes, mais pas aux juifs arabes. L’autre alternative au sionisme, ce n’est pour l’instant qu’une idée défendue par un petit nombre de personnes, c’est celle qui consiste à élaborer un discours d’inclusion du peuple israélien, qui se débarrasserait de sa structure politique actuelle pour s’intégrer à la région, donc au monde arabo-musulman. Mais ça ne peut pas être une proposition israélienne, ça ne peut être qu’une demande israélienne (Amnon Raz-Krakotzkin). En revanche, ça peut être une proposition arabe progressiste [ça l’a été par le passé, par la bouche du député Azmi Bishara, Ndlr] et pour répondre à la peur des Israéliens de devenir une minorité, elle doit être accompagnée de garanties.
Aujourd’hui, le gouvernement israélien ne parvient pas à organiser la reconstruction. Une des raisons en est son attitude discriminatoire à l’égard des périphéries. L’abandon de Kiryat Shmona, dans le Nord, ou de Sderot, dans le Sud, ne date ni des Qassam, ni de la guerre du Liban. Il est structurel, il remonte à l’époque où on installait les juifs arabes sur les frontières du pays, après l’expulsion de 1948, la Nakba des Palestiniens. Aucun mouvement socio-religieux capable de prendre en charge cette population et de combler les carences de l’État n’a émergé. Le sionisme a prétendu remplir cette fonction pendant des années, mais il ne l’a pas fait. Avec l’arrivée du Likoud au pouvoir dans les années 1970, la deuxième génération des juifs maghrébins a eu le sentiment d’être enfin entendue, mais ça ne s’est pas traduit dans les faits.
Si l’on replace dans une perspective historique l’attitude actuelle américano-européenne qui consiste à accorder un statut d’exception à Israël, elle est à mettre en parallèle avec l’attitude spécifiquement européenne qui a donné lieu au génocide des juifs. C’est la politique d’exclusion et d’exception à l’égard des juifs, elle n’a pas changé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et les seuls capables de proposer une rupture avec cette attitude de traitement spécial, ce sont les Arabes et/ou les musulmans. Pourquoi ? Parce que ce traitement spécifique post-deuxième guerre mondiale est semblable à l’attitude qui prévaut à l’égard du monde arabo-musulman. Lutter contre la discrimination, cela implique de lutter à la fois contre la discrimination positive et contre la discrimination négative.
C’est ce qu’Edward Saïd appelait « tenir ensemble les deux bouts de la corde » ?
Oui, sauf que ce qui pose problème, c’est l’endroit où les tenir ensemble. Parce que ça implique de faire exactement ce qu’on demande au sionisme de faire et qu’il ne fait pas : distinguer entre Israël d’un côté et Israéliens de l’autre. Cette distinction passe par la proposition : Israel est un État assassin, mais les Israéliens sont des victimes. Ça veut dire que les interlocuteurs naturels sont les « colonisés » israéliens - la périphérie, et notamment les juifs arabes -, pas seulement les « colons » israéliens (qui peuvent éventuellement être les mêmes, mais considérés sous l’autre aspect, celui de leur instrumentalisation).
Rappelons qui sont les habitants des colonies de Cisjordanie : sur 380 000 d’entre eux, plus de 250 000 s’y trouvent pour des raisons socio-économiques ; toutes les colonies des environs de Jérusalem, au nord ou au sud-est sont habitées à 90% par des juifs orientaux chassés du centre de Jérusalem par la transformation de leurs quartiers d’origine en quartiers de yuppies. Il y a une très forte incitation socio-économique vers les Territoires palestiniens occupés.
Qu’est-ce qui te fait croire que, quand bien même une telle force de proposition, venant des Palestiniens, était entendue par un nombre non négligeable d’Israéliens (et il faut se souvenir que lorsqu’Azmi Bishara a tenu un discours de ce type il y a des années, la plupart des Israéliens ont pris cela comme une provocation), les États-Unis et l’Europe ne s’y opposeraient pas ?
Pourquoi après la deuxième guerre du Liban ce discours peut-il être audible internationalement ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à une autre question à laquelle on n’a que des réponses trop faciles. Le soutien prétendument inconditionnel à Israël, dans ses diverses variantes américaines et européennes, est un soutien qui dérive du fait qu’Israël a un statut d’exception chez les Etats d’Occident. C’est l’attitude du « oui mais », le veto systématique des Etats-Unis à l’ONU, l’attitude d’indignation des Européens(quant à l’Allemagne, elle n’a pas d’état d’âme, elle vend des sous-marins à Israël pendant la campagne du Liban).
Si on se pose la question du droit international, prenons deux pays qui contreviennent clairement et régulièrement aux droits de l’homme : la Chine et l’Arabie saoudite. Toute personne sensée sait pourquoi on n’applique pas les sanctions et pourquoi on n’exige pas le respect des droits de l’homme dans ces pays : il y a le marché chinois et la puissance économique de la Chine, et il y a le pétrole saoudien. Ce sont des raisons suffisantes pour qu’au niveau international, le décalage entre politique et morale soit parfaitement lisible. On sait très bien qu’aucun pays européen ne prendra de sanctions contre la Chine malgré le Tibet, les camps de concentration, ou contre l’Arabie saoudite malgré sa législation. Personne ne s’interroge sur les raisons qu’on connaît pourtant. Quand on s’interroge sur le cas d’Israël, qui est également traité sur la scène internationale en État d’exception, on a tendance à expliquer ce statut comme dérivé d’une attitude sentimentale qui détermine la politique, notamment européenne, et qui s’appelle la culpabilité. Moi je n’y crois pas. Pour les Américains, les enjeux stratégiques sont plus clairs, mais ils sont identiques pour les Européens, et on peut inclure dans cette perspective le rôle de laboratoire que joue Israël pour l’élaboration des méthodes de guerre et de gestion sociale à venir. Sauf qu’à l’issue de cette deuxième guerre du Liban et avant cela, au vu de la situation de Gaza, on voit qu’Israël, aujourd’hui, est incapable de répondre aux attentes occidentales, même au plan militaire. Je disais tout à l’heure qu’Israël n’est plus en mesure de faire ce que l’Occident attend de lui. Ça, c’est un changement ! Israël peut toujours bombarder une centrale nucléaire iranienne, comme il l’a déjà fait en Irak, il peut être une tête de pont militaire en Orient, mais c’est une tête de pont qui n’est plus fiable. En tous cas ça ne va plus de soi.
Je voudrais terminer cet entretien par une anecdote. J’étais à Sderot en juin, c’est une période où les tirs de Qassam sur la ville étaient à leur comble. J’étais en contact avec des militants et des éducateurs des quartiers, des gens de la deuxième génération de Marocains et d’Algériens nés à Sderot. Il faut avoir à l’esprit le fait qu’ils ont connu Gaza avant les bouclages, c’est-à-dire avant Madrid et Oslo. Leurs souvenirs de Gaza, c’étaient les restaurants, le poisson sur la plage, les ouvriers qui venaient quotidiennement travailler en Israël, les marchands de fruits et légumes, les courses qu’ils faisaient là-bas parce que les viandes, les légumes et les poissons étaient moins chers. À Sderot, un élément visuel important, c’est l’avenue Menahem Begin, la principale artère, qui débouche sur la place Mohammed V. Ça veut dire quelque chose : la révolte de Wadi Salib en 1953 et les juifs marocains qui défilaient en appelant le roi du Maroc à leur secours ! Amir Peretz est l’ancien maire de Sderot. C’est une ville abandonnée par le sionisme. Dans les années 1950, les juifs nord-africains arrivaient par camions qui les déversaient dans le désert, sur la frontière avec Gaza. Tout autour, il y avait les kibboutz. Le taux de chômage est explosif, la pauvreté galopante. Bon. Un jour, il y a eu un portrait de moi sur quatre pages dans le quotidien Yediyot Aharonot. Quand j’ai revus les militants associatifs, ils se sont montrés ambivalents : heurtés par mes positions antisionistes, mais ils voulaient discuter, à cause de ma critique de la gauche sioniste et des Ashkénazes de Tel-Aviv. Le dialogue était donc possible. Pour eux, je n’étais pas un gauchiste comme les autres, notamment par mes positions sur la laïcité et sur la question sociale. Pour eux, quelqu’un qui parle contre la laïcité ashkénaze et qui pose la question sociale, c’est pas un gauchiste ! Un gauchiste, c’est un propalestinien qui déteste les juifs orientaux. Et donc, la conversation porte sur le fait que je mets en avant le paradoxe suivant : Sderot vit dans l’abandon social depuis les années 1960 et est symboliquement inexistante, alors qu’elle se trouve à 70 km de Tel-Aviv. On n’en parle que quand des Qassam tombent dessus. Je leur dis donc : maintenant qu’il y a les Qassam du Hamas, on parle de vous ! Et comment en parle-t-on ? Sur le mode de la propagande. Derrière les feux de la rampe et Bernard-Henri Lévy, c’est la ville où il y a le plus de gens qui vivent des aides sociales. Et rien ne change sur le plan social. Je leur dis : on parle de vous, mais qu’est-ce qui change pour vous ? Rien. Sur l’analyse, évidemment ils sont d’accord. Ils ajoutent qu’il suffirait d’un Qassam sur Tel-Aviv, pour que Gaza soit rasée et la question serait réglée. Leur première attitude est donc clairement exterminatrice. Mais quand on leur demande si l’éradication de Gaza changerait quelque chose socialement pour la ville de Sderot, ils n’ont pas de mal à convenir que non. Et alors, je leur propose d’analyser l’histoire des juifs orientaux dans sa dimension périphérique : ils ont été placés sur la frontière parce qu’ils étaient arabes et pour faire « tampon » avec les Arabes. Ils se retournent alors contre le monde arabe pour expliquer leurs malheur et ce regard tourné vers l’extérieur épargne le centre de ses critiques. Il est alors facile de leur montrer qu’il y a davantage d’affinités sociales et culturelles avec les gens de Gaza qu’avec ceux des kibboutz voisins ou de Tel-Aviv. Ils reconnaissent facilement que ceux qui tirent les Qassams sont à leur image : c’est eux, dans une situation extrême. Ils sont conscients des difficultés économiques et de l’enfermement. Ils disent alors : « On est prêts à aller à la barrière pour leur parler, organisez-nous une rencontre et on leur parlera à hauteur des yeux, loin du pouvoir. » Là est notre faillite, à la gauche laïque, aux anti-coloniaux. On n’a plus cette passerelle que représentaient naguère les Panthères noires avec le Fatah. Et aujourd’hui, cette passerelle passe pour moi par le mouvement socio-religieux et politique dans le monde arabo-musulman. Elle ne peut pas être fournie par la gauche ashkénaze et laïque.
Au Maroc, un petit groupe de gens s’est récemment réuni pour déposer une plainte devant la justice marocaine contre Amir Peretz, pour crimes de guerre. Amir Peretz est toujours sujet marocain, et en tant que tel, il peut être poursuivi pour les crimes commis au Liban sous sa responsabilité de ministre de la Défense israélien. Eh bien je trouve ça formidable, mais ce qui est dommage, c’est que ce groupe n’est composé que de juifs marocains. Tu imagines, s’il avait été composé de juifs et de musulmans marocains, la puissance d’inclusion que cela aurait eu ? Amir Peretz, poursuivi en tant que Marocain, par des Marocains, et pas seulement par des juifs marocains progressistes. Eh bien ce mouvement d’inclusion qui n’existe pas encore, je crois que c’est de là que viendra la sortie du tunnel.
Dossier "Entre deux guerres", proposée par Joëlle Marelli
Entretien avec Eyal Sivan, réalisé le 24.8.2006 par Joëlle Marelli pour www.indigenes-republique.org