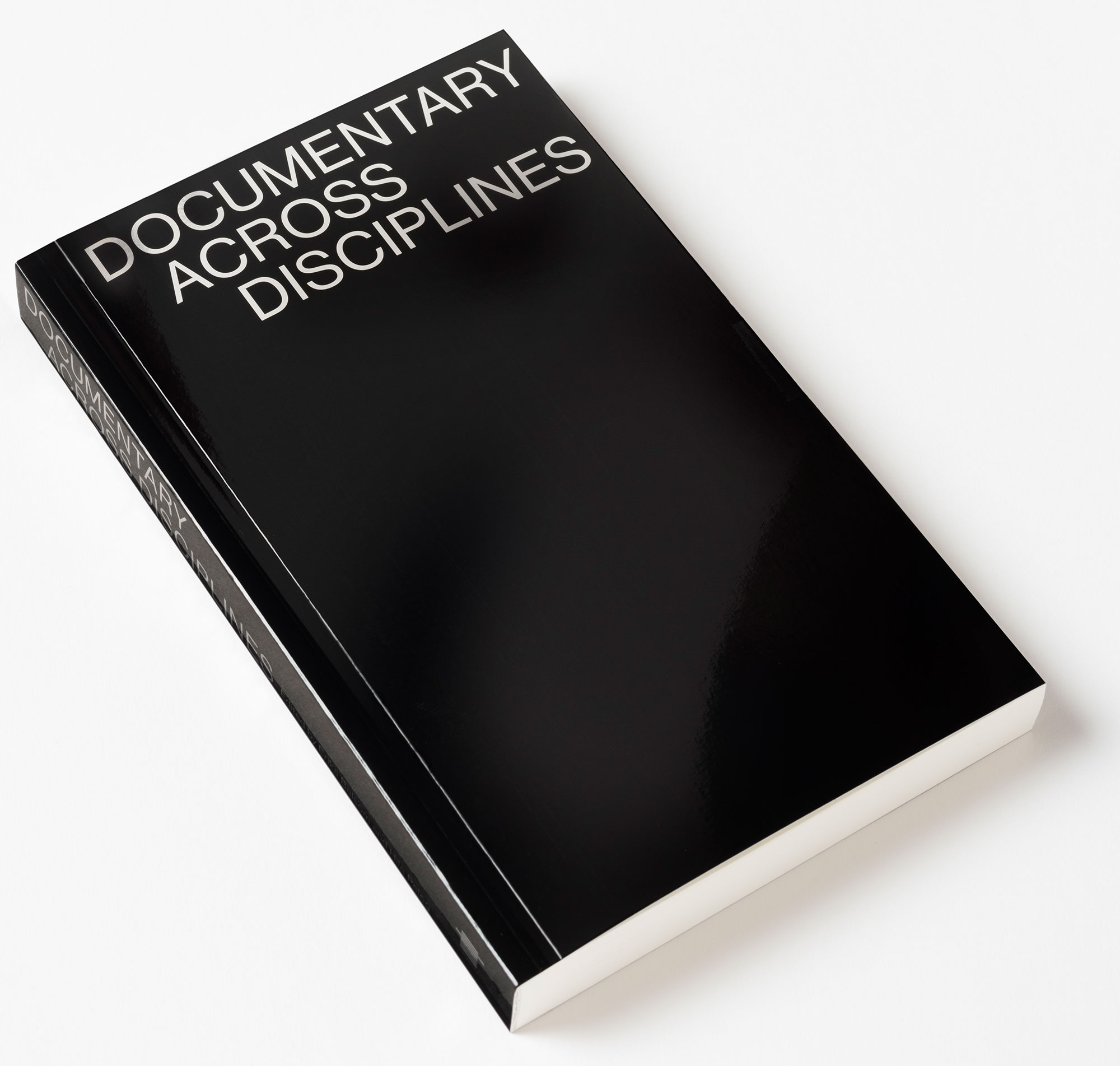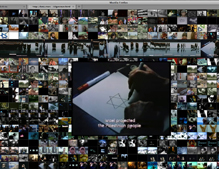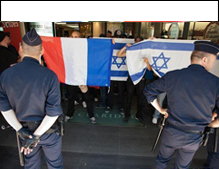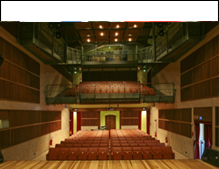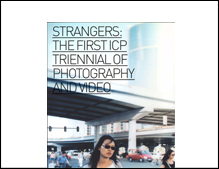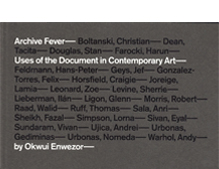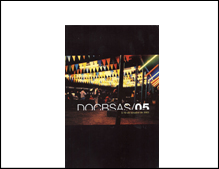-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
reviews
Scènes proches orientales by Joëlle Marelli
01.05.2005
« La politique est l’art des déductions tordues et des identités croisées. Elle est l’art de la construction locale et singulière des cas d’universalité. »
Jacques Rancière, La mésentente, Galilée 1995, p. 188.
Be the truth unsaid and the blessing gone
If I forget my Babylon
Leonard Cohen
Jacques Rancière, La mésentente, Galilée 1995, p. 188.
Be the truth unsaid and the blessing gone
If I forget my Babylon
Leonard Cohen
Cela se passe dans le « centre d’intégration » de la ville de Lod, au cœur d’Israël. Une cérémonie. Des hommes et des femmes sont assis en longues rangées. Beaucoup sont âgés. Devant eux, une femme parle, puis une autre, puis un homme. Un homme traduit. On lève de petits gobelets, un homme fait la grimace. Tout le monde a l’air fatigué. Mais le visage de la lassitude n’est pas le même de part et d’autre. La femme qui parle et lève son verre grimace aussi, d’une autre grimace que celui qui n’apprécie pas le vin. On pourrait dire qu’elle sourit, qu’elle essaie de sourire, et que son sourire tourne en grimace avant d’avoir eu le temps de s’épanouir. Le sourire-grimace de cette femme, face aux visages gris et graves à qui sa mimique est adressée, nous surprend, nous gêne, nous effraie. C’est dans La classe morte de Kantor que nous avons vu une scène de ce genre, des sourires-grimaces, des gesticulations, un auditoire morne au visage crayeux. L’effroi du public, notre effroi, nous le projetions sur ces masques las, sur ces corps d’où l’âme semblait absente.
Je repense à Kantor en voyant pour la troisième fois la séquence des immigrés éthiopiens dans le film de Michel Khleifi et Eyal Sivan, Route 181. Je revois la classe morte et les pantins gesticulant devant les mornes gradins peuplés de regards éteints.
Mais les regards des Ethiopiens du film ne sont pas éteints. Fatigués et marqués par la compréhension – devant les gesticulations des personnes chargées de la maigre pompe déployée en leur honneur – d’avoir été joués, dans l’accomplissement du voyage qui les a conduits jusque là. Aux murs, des photos de leurs villages, d’eux dans leurs villages. Rien n’est dit de leur histoire, rien n’est explicité de leur « origine ». On hésite d’abord : des Fallachas, aujourd’hui encore, arrivant d’Ethiopie ? On apprendra plus tard que, non, ce ne sont pas des Fallachas, mais des Ethiopiens chrétiens pratiquant certains rituels juifs, que l’Agence juive a entrepris de faire venir en Israël. Incessante répétition de l’opération de mise en exil, d’installation exilique dans l’Etat juif, dans l’Etat des juifs ayant abandonné l’exil pour rentrer « chez eux ». À d’autres moments du film, on voit les ancêtres, en termes de cet exil paradoxal, de ces Ethiopiens amenés de chez eux, fuyant qui sait quelle effective misère pour rejoindre une promesse qui se dissout devant eux, dans des pantomimes sans grâce qui les accueillent sans tendresse (ils ne sont là que pour modifier un « équilibre démographique »), dans le petit verre de vin sucré qu’ils boivent en fronçant le sourcil. Leur ancêtre en termes d’exil, c’est d’abord ce vieil Irakien que l’on voit au début du film, et dont le regard semble fixé dans son étonnement d’enfant, enlevé dans l’enfance à son Irak natal. Si je pourrais vivre avec les Arabes ? dit-il. Bien sûr que je le pourrais, quelle drôle de question. Je sais bien leur langue, je vivrais très bien avec eux. Si l’Irak me manque ? Il rit. Tu me demandes ça aujourd’hui ? Tu te moques de moi ? Dans ce rire, dans les larmes qui tremblent au fond de ses yeux, il y a le désarroi de celui qui sait bien aujourd’hui que « son pays », c’était bien l’Irak. Lui a-t-on demandé, à l’époque, s’il voulait le quitter pour Israël ? Non. Il s’agissait alors de faire exister une certaine distribution démographique, pour que puisse survivre un Etat et la définition qui avait été le principe de sa fondation. La définition d’une identité, la fondation d’une identité commune, la mise au creuset de la communauté nationale d’une identité jusqu’alors tremblée en ses multiples déclinaisons.
À la fin du film, encore, cette femme marocaine, racontant comment dans sa jeunesse elle allait transmettre clandestinement la bonne parole de l’émigration que lui apprenaient des émissaires masqués venus du tout jeune Israël. Mon père, dit-elle, c’est moi qui l’ai convaincu de partir. Lui ai-je porté tort ? Peut-être, dit-elle, souriant adorablement, demandant à la caméra de se détourner d’elle et de filmer plutôt ce bel arbre, là, qui a si joliment poussé. Tandis que nous contemplons la belle forme de l’arbre, se dit alors un savoir profondément contraire à tout ce que nous croyons savoir sur l’exil des juifs et leur « retour à leur histoire ».
Deux séquences de ce film ont causé le scandale en France : l’une, filmée chez un coiffeur palestinien racontant ce que fut, pour lui, 1948, la Nakba. L’autre, un long plan sur des rails de train. Indicible émoi, pétition, annulation d’une projection sur les deux prévues au Centre Georges Pompidou. Il ne s’agissait de rien de moins que du soupçon de « négationnisme », ce qui n’est pas rien. Pourquoi donc ? Parce que ces deux « citations », en renvoyant au film Shoah de Claude Lanzmann, devaient « forcément » supposer une équivalence entre deux événements que l’histoire a choisi de retenir sous le même vocable, dans deux langues différentes : « Shoa » et « Nakba » signifient en effet tous deux « catastrophe », ou « désastre ». Imputation de mise en équivalence, donc, et de ce fait, lourd soupçon pesant sur les réalisateurs : vous récusez l’unicité et l’imprésentabilité. L’unicité, puisque vous citez « Shoah » le film, pour dire : là aussi il y a des rails, là aussi des coiffeurs furent victimes et témoins. L’imprésentabilité, puisque vous faites de ces séquences emblématiques, de ces rails signe de l’atroce, de ce coiffeur figure de la victime, des « figures » esthétiques pouvant être reprises, citées pour dire autre choses que ce qu’elles disaient dans le film initial. Vous êtes donc suspects, plus que suspects. Dans ce domaine, la suspicion tient lieu de pensée.
Or ce que font Sivan et Khleifi, ce n’est rien d’autre que de tenter par des moyens cinématographiques de prendre au mot cet énoncé du poète juif israélien Avot Yeshurun : « La catastrophe des juifs et la catastrophe des Arabes ne sont qu’une seule et même catastrophe. » Ce n’est pas une mise en équivalence, ce n’est même pas la récusation d’une hiérarchie – c’est bien la mise en fusion historique, la revendication d’un même appareil explicatif pour ces deux séquences d’un même désastre. Quelles sont donc les clés de cette réunification des « ennemis » à travers une lecture de l’histoire dont le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’est pas majoritaire ?
La question est peut-être tout autant : qu’est-ce qui nous rend ce « conflit » si proche, si intime parfois, qu’est-ce qui nous le rend si faussement lisible, comment ce conflit a-t-il pris pour nous les contours somme toute familiers de la tragédie, soit d’une scène répétitive où nous reconnaissons toujours tout : les acteurs, le décor, la fable. Cette lisibilité apparente, nous voudrions ici, au fil de ces pages comme un rendez-vous, solliciter des rencontres, des lectures, des interventions pour tenter d’en défaire les attendus, la belle évidence interprétative, pour y trouver la contradiction de nos certitudes d’Européens, de Français, d’étrangers présents et anciens, de descendants d’immigrés et de colonisés.
Dans Les émigrants, dans Austerlitz, Sebald montre avec une intensité poignante comment l’exil peut marquer un être au point de le rendre définitivement étranger au monde. Toute la question est alors de savoir quels sont les rapports nouveaux - sans doute nécessairement poétiques, nouveau « partage du sensible » comme le dit Rancière - qui rendent possible la restauration d'une appartenance à ce monde désormais creusé d'une faille. Il ne s’agit donc pas d’idéaliser l’exil, dont la réalité est souvent une blessure. Il s’agit de voir comment, dans la pensée sioniste, le discours sur l’exil et sur sa négation a fonctionné comme opérateur d’exil ; comment cette question théologique est devenue une question historique qui s’est imposée non seulement aux juifs mais aussi aux Palestiniens, comment les Palestiniens ont été forcés de partager cette question transformée en destin.
I. Exil et binationalisme : Amnon Raz-Krakotzkin
« Tu dis : comment un homme devient-il Avot Yeshurun ? La réponse est – des cassures. J’ai cassé ma mère et mon père, je leur ai cassé leur maison, je leur ai cassé leurs nuits de repos. Je leur ai cassé leurs fêtes, leurs shabbats, je leur ai cassé leur valeur à leurs propres yeux. Je leur ai cassé leur éloquence. Je leur ai cassé leur langue. J’ai exécré le yiddish, et leur langue sacrée je l’ai prise pour mon quotidien. Je leur ai fait exécrer leur vie. J’ai quitté l’association. Et quand l’heure sans issue est descendue sur eux, je les ai abandonné dedans le sans-issue. Alors je suis ici. Dans le pays. J’ai commencé à entendre une voix qui sortait de moi, étant seul dans la baraque, sur mon lit de fer, une voix qui m’appelait par mon nom-de-la-maison, et la voix – une voix de moi à moi. Ma voix sort du cerveau et s’étend dans tout le corps, et la chair tremble encore longtemps après, alors j’ai commencé à chercher un moyen de fuir et de changer le nom et le nom de famille, avec le temps j’ai réussi à hébraïser les noms. Cela avait la valeur de la défense. En présence de la voix, je me suis éveillé. J’ai craint de m’endormir encore. »
Avot Yeshurun, « Pti’ha le-raaïon »,
Ha-shever ha-souri-africani, poèmes.
Historien du judaïsme, professeur à l’Université Ben-Gourion du Néguev (Beer-Shéva), Amnon Raz-Krakotzkin cite volontiers Avot Yeshurun, ce poète juif israélien, dont le vrai nom est Yichiel Perlmutter, qui ne fut jamais antisioniste, mais décrit le poids du sionisme sur les vies individuelles, sur les filiations, sur les processus de subjectivations individuelles, de reconstruction de subjectivités marquées par l’histoire. Cette parole saisissante donne une perception sensible de la dimension de déni, de refus de se souvenir que représente le projet sioniste.
Dans la pensée sioniste, la « négation de l’exil » marque la volonté de soustraire les juifs au passé de vulnérabilité qui marque la période dite exilique (de la destruction du Second Temple jusqu’au « retour » en terre d’Israël), vulnérabilité dont le facteur principal serait l’absence de souveraineté politique des juifs sur un territoire qui leur appartiendrait. La souveraineté juive restaurée sur la terre retrouvée doit permettre un renouveau culturel indexé à la figure du « Nouveau juif », contraire en tout point de la figure du juif exilique, sur lequel pèsent des tares concordant exactement avec celles que l’antisémitisme européen attribue au juif, comme d’ailleurs l’orientalisme à l’Oriental : faiblesse, passivité, féminité, dégénérescence.
Si l’on suit la pensée de la négation de l’exil, la période exilique est dépourvue de qualités propres, positives. Ces deux mille ans sont perçus comme un long entre-deux, un âge de peu : le pays-même était en exil, il s’est agi pour le sionisme de le rendre à lui-même et à l’histoire (« rédemption de la terre », « retour à l’histoire »). Or cette représentation de la terre en exil d’histoire a pour conséquence, explique Raz-Krakotzkin, une triple négation : celle de l’histoire de la terre de Palestine, celle de l’histoire des Palestiniens et celle des histoires des juifs, soit de ces séjours souvent immémoriaux des juifs en des terres où ils n’étaient pas souverains mais où cependant, ils furent acteurs de l’histoire et non pas systématiquement ses victimes. La culture israélienne s’est construite en niant souvent les cultures juives diasporiques, en particulier les cultures juives arabes.
La négation de l’exil est d’abord comprise par ses auteurs (penseurs, écrivains et historiens sionistes) comme un processus de « normalisation » de l’existence juive. « Négation de l’exil » et « retour à l’histoire » se rejoignent dans une interprétation rédemptive de l’histoire, héritière directe d’une pensée romantique qui assigne à celle-ci toutes les qualités conférées par l’Eglise à l’idée de grâce. Le retour à la terre (vide et à « rédimer ») est compris comme l’accomplissement de l’histoire juive et la réalisation d’une nostalgie ancestrale dont témoignerait la liturgie (« Si je t’oublie Jérusalem… »). L’idée de cette normalisation, à l’époque moderne, passe par la sécularisation et la transformation en « nation ». Raz-Krakotzkin montre que la « nationalisation » de l’existence juive au fil de processus comme celui de la Haskala (les Lumières juives), de l’émancipation, puis de l’échec de celle-ci dans la vision du sionisme naissant, correspond à une identification à la sécularisation chrétienne, autrement dit à la traduction politique des principes chrétiens. Le sionisme, constitué dans le rejet radical de la solution assimilationiste, est ainsi en réalité un mouvement qui tend à assimiler l’existence juive à l’Occident , en incarnant l’Occident dans l’Orient colonisé. « Paradoxalement, la sortie d’Europe se fonde sur un objectif d’intégration à l’Occident, avec l’adoption des principes et des valeurs qui ont rendu possible l’exclusion des juifs d’Europe. La conscience historique sioniste a tenté d’accomplir une transformation à partir de l’assentiment donné aux représentations élaborées contre les juifs dans le discours européen moderne. »
Or, dans la pensée juive traditionnelle, l’idée d’exil remplit une tout autre fonction que celle que lui assigne la pensée sioniste : « Sur un plan élémentaire, le terme d’« exil » se réfère effectivement à la dispersion des juifs ainsi qu’à leur statut politiquement et socialement inférieur [dans les pays d’accueil]. Cependant, ce statut inférieur était considéré comme témoignant de la condition universelle. L’exil renvoie à un état d’absence, pointe l’imperfection du monde et entretient le désir [d’un autre monde]. D’après un certain nombre d’auteurs (essentiellement cabbalistiques), l’exil décrit la situation de la divinité même, autrement dit, c’est Dieu qui est exilé de l’« histoire ». De ce point de vue, l’existence exilique ne se situait pas « hors de l’histoire », mais incarnait plutôt la condition même de l’"histoire". » (« Redemption and Colonialism », p. 4)
Grand lecteur de Walter Benjamin, Amnon Raz-Krakotzkin propose cette lecture de l’histoire « à rebrousse-poil » non dans le seul but de déboulonner les mythes. Il s’agit pour lui d’écrire l’histoire « du point de vue des victimes », du point de vue de « l’instant d’avant la catastrophe », pour rouvrir des possibilités dans un contexte qui apparaît barré de toutes parts.
La pensée binationale ou le « retour dialectique à l’exil »
Le sionisme a produit une réalité : des millions de juifs israéliens considèrent ce pays comme le leur, y sont nés, parlent une langue qui n’a pas d’existence ailleurs. Bien souvent, le rapport qu’ils entretiennent avec ce pays est cependant fondé sur le déni ou l’occultation : du pays lui-même, de son histoire et de l’histoire de ses populations, arabe et juive-arabe en particulier.
Le « retour dialectique à l’exil », ce n’est donc pas le renvoi des juifs dans la diaspora, ni la « remise en question de l’existence d’Israël », avec tout ce que cette expression peut convoyer de charge émotionnelle en particulier en France. C’est, pour Raz-Krakotzkin, la prise en compte de ce qui a été refoulé dans l’accession à la souveraineté, la redéfinition des principes qui fondent la co-appartenance, la reconnaissance du droit de l’autre dans le temps même de l’énonciation du droit propre. C’est donc une exigence qui porte sur la formulation des droits, droits des Palestiniens, mais aussi droits des juifs, à ce jour illimités et donc, d’une certaine manière, inexistants, ce qui explique que « chez les juifs israéliens, la simple idée d’une réalité d’égalité et de justice historique éveille une angoisse existentielle qui met en évidence les fondements sur lesquels repose la conscience existante. »
Michel Warschawski résume ainsi cette pensée : « En fait, il s’agit là d’une volonté de retour à la dimension diasporique de l’identité juive : le sionisme s’est voulu la négation de l’exil et de l’identité juiv e diasporique. Or cette identité s’est formée et s’est développée en interaction permanente avec son environnement non juif – prenant parfois des formes extrêmement oppressives – sous la forme d’un échange perpétuel et d’un dialogue extrêmement riche et créatif. Le sionisme a voulu mettre fin à l’oppression en mettant fin au dialogue et à l’échange, en s’isolant dans un bunker, ayant le moins d’interactions possible avec le monde et une relation hostile à son environnement arabe direct. (…)L’option binationale remet en question cette négation de l’exil qu’incarne le sionisme, et redéfinit l’identité juive israélienne dans une relation aux Palestiniens, comme "partie intégrante de son autodéfinition". »
La pensée binationale ne doit donc pas être confondue avec une « solution » binationale substituée à la « solution à deux Etats » dans le règlement du conflit entre Israël et les Palestiniens. Elle ne s’oppose pas au règlement à deux Etats, pas davantage qu’elle ne se confond avec les différentes solutions avancées historiquement par des mouvements antisionistes : Etat binational ou Etat démocratique et laïque de la Méditerranée au Jourdain. Pour Raz-Krakotzkin, dans la configuration actuelle, on ne peut faire l’économie d’un Etat palestinien, sauf à prolonger l’ordre oppressif existant. Ce à quoi, en revanche, s’oppose la pensée binationale, c’est à la pensée de la séparation, principe et cause de l’échec du « processus d’Oslo », et qui a conduit la gauche israélienne à imaginer le mur de béton qui entaille aujourd’hui le territoire palestinien et rend littéralement invivable le quotidien des Palestiniens. Raz-Krakotzkin nous rappelle que c’est Ehoud Barak, avec son slogan emprunté au parti d’extrême-droite Moledet (« Nous ici et eux là-bas »), qui avait fait de la séparation son cheval de bataille. Or l’idée de séparation n’est pas très éloignée de celle, infiniment moins acceptable, de « transfert ». On sait qu’elle s’appuie sur une difficulté propre à la définition de l’Etat comme Etat « juif et démocratique ». Etant donné la réalité démographique, cette définition ne tient déjà plus. Soit l’Etat israélien est juif, soit il est démocratique. La gauche en est donc venue, dans une tentative quelque peu pathétique de résoudre cette contradiction, à défendre la séparation, l’homogénéité démographique, pour qu’Israël puisse rester un Etat à la fois juif et démocratique.
La pensée binationale, c’est avant tout la reconnaissance d’une situation réelle. Raz-Krakotzkin cite ici Meron Benvenisti, qui le répète depuis des années : c’est d’abord la réalité qui est binationale, ou multi-nationale si l’on préfère. En Israël/Palestine vivent en effet imbriquées des populations juives et non-juives et seule la politique du transfert (ou nettoyage ethnique) peut venir à bout de cette coexistence de fait. Il importe peu au fond de savoir quelle solution étatique verra finalement le jour et règlera la coexistence. Pour être viable, elle devra de toute façon comporter un élément binational.
Essentielle, de ce point de vue, est la critique mizrahi, du nom que se sont donnés les juifs originaires des pays arabes. La sensibilité à la dimension orientaliste inhérente à la culture israélienne et à son double rejet de l’arabité et du religieux ouvre sur une critique de plus grande portée et sur une sortie possible de l’impasse au prix d’une révision des catégories en vigueur. C’est une erreur d’analyse que d’identifier les causes du blocage dans la série dichotomique laïques-religieux, gauche-droite, juif-arabe.
(à suivre)