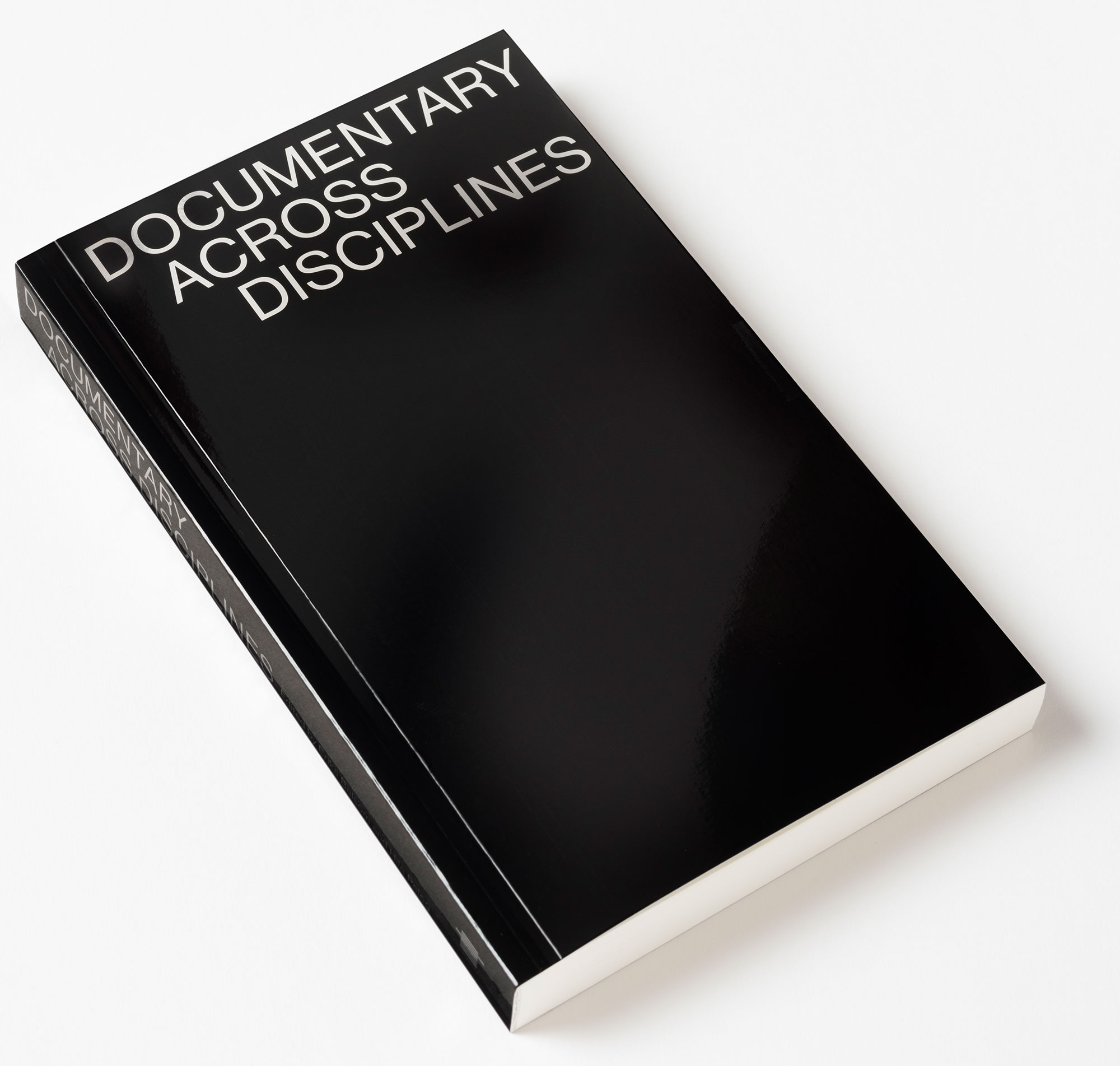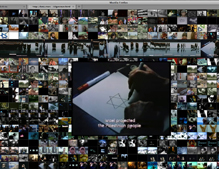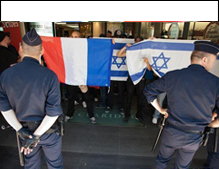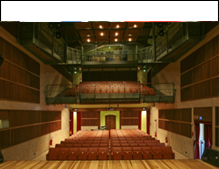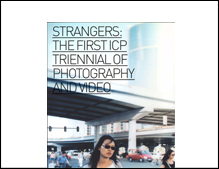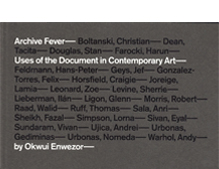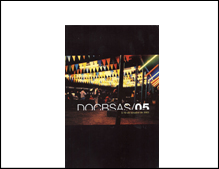-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
SOUS LA BOMBE DU TEMPS...
Avec l'Israélien Eyal Sivan, pas de doute possible, nous sommes au cœur de la Méditerranée...
Dans un espace tout d'abord, une géographie spécifique et contradictoire : cette mer, ouverte à tous les départs, aux ailleurs infinis, est une mer fermée, un espace clos dans et autour duquel les Méditerranéens circulent, sans relâche...
Parce que les déplacements là-bas sont fondamentaux et constitutifs : qu'ils soient volontaires ou imposés, on ne finirait pas d'en énumérer les différentes déclinaisons : transhumances, commerces de tous ordres, pèlerinages, conquêtes, occupations, exodes, exils, diasporas...
Peut-être pour ça que la terre, l'espace dans son sens le plus physique, prend une telle charge affective et devient un enjeu vital : parce qu'elle est le lieu de l'enracinement, des origines, de l'identité.
Ne plus être inscrit dans cet espace, perdre la terre, en être privé, c'est perdre l'identité. S'opère alors une reconstruction imaginaire et mythique de cet espace perdu qui s'installe dans une temporalité très longue, celle des racines, du souvenir, d'une tradition qui se transmet et se perpétue, avec toutes les résonances bibliques que cela suscite : la Terre Promise...
Mais ce temps de la mémoire, cette continuité cyclique éternellement recommencée est agitée par un autre rythme, un autre temps événementiel très rapide et fait de ruptures, qui accélère les contradictions et engendre des générations très courtes et différentes...
Quinze ans séparent Amos Gitaï que nous recevions en 1986 et Eyal Sivan : la filiation qui les unit est indiscutable et Eyal s'en réclame avec force et passion. Plus qu'un aîné, Gitaï est pour lui un maître qui a ouvert la voie, le plus grand documentariste israélien.
Mais quinze ans dans ce coin de Méditerranée, c'est énorme ! "Nous sommes sous la bombe du temps. Demain peut voir l'avènement d'une nouvelle génération, nous sommes dans l'urgence" nous disait Eyal Sivan lors de son passage à Montpellier en novembre 1987. L'actualité récente lui a trop vite donné raison : il existe, depuis, une nouvelle génération, celle de la "révolution des pierres"...
Pour l'homme et le cinéaste, comment combiner ces espaces et ces temps contradictoires ? Comment vivre mémoire et quotidien ? Comment éviter le "marketing de la mémoire" ? En tentant de réinstaurer un tant soit peu de circulation et de dialogue : en réfléchissant, en prenant le recul et le temps de la réflexion, ce qui rend l'exil nécessaire. En montrant de son pays d'autres réalités et d'autres images que celles, dominantes, univoques et uniformes, des actualités télévisées. En cherchant à créer une nouvelle forme justement qui échappe à l'éternelle logique de l'étiquetage "cinéma militant" (cinéma du réel donc pauvre), "cinéma de distraction" (déconnecté du réel mais riche). Revendiquer une exigence technique et esthétique très poussée car même -et d'autant plus- lorsqu'il est documentaire, le cinéma est un "show" ; mais ce "show" doit être profondément imprégné de la culture et de l'histoire d'Israël et de ses peuples, un show méditerranéen sans aucun doute...
Pari de taille, on en conviendra mais pari tenu avec Aqabat Jaber, le premier film de Sivan. Bonne route Eyal et à l'année prochaine... à Montpellier !
Michèle Driguez
Actes des 9e rencontres de Montpellier
Débat public après projection de Aqabat Jaber, animé par Michèle Driguez, le 1er novembre 1987.
Michèle Driguez : Aux Rencontres, nous sommes attentifs à tous les cinémas du Bassin Méditerranéen et Israël est un pays méditerranéen. L'année passée, nous recevions Amos Gitaï qui nous présentait trois de ses documentaires et son premier film de fiction Esther. Nous continuons aujourd'hui avec Eyal Sivan qui nous propose Aqabat Jaber. Eyal, pourrais-tu te présenter au public, nous dire ton âge car je crois que tout le monde ici est impressionné par Ion extrême jeunesse. D'où viens-tu et quel a été ton trajet avant d'arriver à Aqabat Jaber ?
Eyal Sivan : Je suis né en Israël, il y a vingt-trois ans, à Haïfa. Aqabat Jaber est mon premier film, mon premier long-métrage, mon premier documentaire... Auparavant, j'étais photographe. C'est comme ça que je suis arrivé au camp d'Aqabat Jaber, je faisais une séance de photos de mode et j'ai trouvé ce camp très beau, le désert magnifique. J'y ai amené un mannequin, une très belle blonde, je l'ai placée devant les ruines -pour moi, le camp était abandonné- et j'ai commencé mes photos. Tout à coup, des enfants sont sortis et j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui vivaient là. Bien sûr, nous n'avons pas fait les photos. Et puis j'ai trouvé un charmant producteur français à qui mon idée a plu et nous avons produit le film.
Aqabat Jaber, village fantôme ?
Aqabat Jaber, aujourd'hui, personne ne connaît c'était le plus grand camp de réfugiés palestiniens construit au début des années cinquante, là où s'étendent aujourd'hui les territoires occupés : la Cisjordanie, à l'époque territoire jordanien. Il y avait soixante-cinq mille (certains disent soixante-quinze mille) habitants. En 1967, Aqabat Jaber a été abandonné par la majorité de ses habitants : il n'y reste aujourd'hui que deux mille cinq cents personnes. C'est un camp différent de tous ceux que nous connaissons, tels que Gaza, Sabra, Chatila, Deheishe, Balata, qui sont des points médiatiques chauds. Aqabat Jaber est un camp apolitique, si je puis dire. Il n'y a pas de gros événements, rien ne s'y passe vraiment sauf la vie de ces gens, une vie très lente. Le film essaie de traiter ce rythme de vie des réfugiés, des exilés, des agriculteurs déracinés et des réfugiés palestiniens.
Public : Je voudrais vous remercier d'avoir donné vie à un lieu qui est mort. Vous avez dit en présentant le film que le camp d'Aqabat Jaber était très peu connu. Il se trouve que je suis allé à Aqabat Jaber et je suis ici peut-être la seule personne avec vous dans ce cas. C'est un camp qui se trouve sur la route qui relie Jérusalem à Jéricho et le souvenir que j'en ai gardé est totalement différent de ce que je vois dans le film. Le souvenir que moi j'en ai est celui d'un décor vide, un camp immense avec des maisons à l'abandon depuis 1967. Je n'ai pas eu, si je puis me permettre, cette attitude de voyeur qui est la vôtre, mais pas au sens négatif du terme : vous avez vu ce que je n'ai pas vu et je vous remercie de m'avoir montré ce que j'ai manqué.
Eyal Sivan : En 1983, trois ans avant le tournage, la majorité des maisons vides ont été détruites par l'armée israélienne en accord avec l'UNRWA, l'Office de Secours des Nations Unies pour les Réfugiés, pour des raisons de sécurité et de salubrité. Le Guide Bleu d'Israël signale Jéricho et dit qu'à main gauche, sur le chemin qui mène à la ville, on peut voir un immense camp de réfugiés palestiniens abandonné qui donne l'impression d'une ville-fantôme. Suit une phrase soulignée : "A éviter"
Public : D'abord merci pour ce témoignage passionnant. Sait-on ce que sont devenus les dizaines de milliers de personnes qui habitaient là auparavant ?
Eyal Sivan : Les gens qui sont partis en 1967 sont maintenant dans leur majorité sur l'autre rive du Jourdain dans un autre camp de réfugiés immense, celui d'Aman, le plus grand aujourd'hui, une énorme ville de réfugiés de cent mille habitants. Une petite fille dit dans mon film : "Mon oncle Omar est parti ; il est d'Aman."
Public: Le film a-t-il été montré en Israël et si oui, comment a-t-il été accueilli par la critique et le public ?
Eyal Sivan : Aqabat Jaber a été projeté dans le cadre du Festival du Film de Jérusalem. Ils avaient décidé d'inviter les trois derniers films primés au Festival du Réel de Paris et Aqabat Jaber en faisait partie. Il a donc été projeté deux fois avec tellement de monde qu'il a fallu une projection supplémentaire. La critique m'a d'abord reproché d'avoir fait ce film avec une maison de production française -des étrangers donc, pas des gens de l'intérieur. De plus, pour la critique, c'était l'étonnement total parce que l'on voit beaucoup de films sur les Palestiniens, sur le conflit, l'occupation, etc. -car Israël est aussi une grande démocratie- mais on ne connaît pas les gens, il n'y a pas de contact avec la population. J'ai eu des réactions très bizarres, assez primaires : "Ah bon, ils épluchent les légumes comme ça..., "Ils ne jettent pas de pierres ?" Il y a eu aussi les réactions politiques habituelles : "Ce n'est pas à nous, Israéliens, de régler leurs problèmes..." L'autre réaction intéressante est venue des progressistes israéliens, des "gauchistes", pour qui il faut trouver une solution aux problèmes de l'occupation. Ils m'ont dit "Mais que veux-tu exactement, avec ton film ? Tu parles de 1948, mais c'est loin. Il faut parler de 67, de Sabra et Chatila..." En Israël, comme dans beaucoup de pays méditerranéens, une génération peut s'étendre sur trois ans, cinq ans. L'histoire est très courte et 1948 c'est déjà vieux et dépassé. Il faut parler de 67, de la guerre du Liban (1982). C'est la réaction qui m'a le plus étonné.
Public : Comment le film est-il né ? Cette longue litanie s'est-elle imposée à vous au fur et à mesure des interviews interview ? Avez-vous fait des repérages qui vous ont permis de concevoir cette forme ?
Eyal Sivan : J'ai commencé à écrire le traitement du film quelques années après avoir été à Aqabat Jaber. J'ai presque écrit une fiction, j'avais des éléments que je voulais utiliser mais pour le reste, j'essayais d'être ouvert. Je savais par exemple que je commencerais par la nuit, que j'aborderais le problème de la terre, celui des sédentaires et des nomades. Il y avait même des scènes que j'avais imaginées. Tout était écrit. Lorsque j'ai terminé, je suis parti pour Aqabat Jaber et j'ai commencé à remplir les trous. J'ai rencontré des gens, j'ai supprimé des choses que j'avais inventées et qui n'existaient pas. L'aspect nomade a pris plus d'importance. Et puis, j'ai pris une quantité énorme de photos, trois cent cinquante environ, pendant une semaine, qui m'a permis de dessiner des cadres, des plans, etc. De retour à Paris, on a développé tout le scénario et je suis reparti à Aqabat Jaber avec mon équipe. J'avais deux chefs opérateurs ce qui me permettait, sur une période très courte, de travailler en même temps en intérieurs et extérieurs. La distribution de vivres par exemple a lieu tous les deux mois et j'avais deux heures pour la filmer : il y avait donc deux caméras qui tournaient en même temps, l'une à l'extérieur avec les sacs de farine, l'autre à l'intérieur pour la distribution de ce liquide jaune qui est de l'huile non raffinée. Voilà pour la façon de travailler.
Le quotidien : rythmes et rituels.
J'avais une chance qui n'est pas celle des habitants du camp : la vie à Aqabat Jaber est comme un rituel, les choses se répètent tous les jours. Le vieux qui longe le mur, Abdul Hamid, est assis toute la journée ; tous les jours, à la même heure, il rentre chez lui pour déjeuner et puis il retourne à sa chaise jusqu'au soir. Ce qui me permettait de poser mon pied de caméra et de travailler presque comme pour une mise en scène : je savais quel cadre j'allais faire, mais je n'avais rien à demander car je pouvais prévoir ce que ferait Abdul Hamid. Et cela est vrai pour beaucoup de gens du camp. Les hommes qui sont assis et boivent le thé par exemple, ont été filmés en deux jours différents mais, on a l'impression de champs contrechamps parce que ces gens sont tout le temps dans les mêmes positions. De même pour l'homme assis par terre, celui de l'affiche du film : le monologue qu'il donne a été enregistré un autre jour. Il était assis pendant une heure, ce qui me permettait de poser la caméra, de placer l'éclairage, etc. Autant de choses qui demandent beaucoup de préparation avec des acteurs. Lui, il n'a pas bougé et dans le film, le plan est très long, trois minutes...
Michèle Driguez : Précisément, comment le rythme de vie quotidien de la population et son rapport à l'espace (contrainte d'immobilité, état provisoire de "stabilisation") ont-ils déterminé ta façon de filmer, de cadrer cette exploration très lente de l'espace avec ces panoramiques très coulés ?
Eyal Sivan : Je voulais effectivement traiter le quotidien et ses rythmes. Et le rythme c'est les plans, les cadrages. Par exemple, ce que je donnais comme indication à l'autre chef opérateur qui se baladait caméra à l'épaule, c'était d'essayer de garder pour tous les plans la longueur maximum, tenter de suivre les gens le plus possible... Avec les deux caméras et avec le regard, essayer d'entrer dans le rythme des gens. C'est d'ailleurs ce qui a donné au film la longueur qu'il a et qui n'était pas initialement prévue.
Pour le montage, j'ai travaillé avec une Américaine qui a monté beaucoup de documentaires aux Etats-Unis et nous avons eu énormément de discussions autour de ces problèmes de rythme justement. Elle me disait : "Bon, ce type assis par terre, on coupe !" (rires). Ça a duré jusqu'à ce qu'elle-même entre dans ce rythme particulier. Avec Nurith Aviv, le chef opérateur israélienne, il n'y avait pas de problème. Raymond Grandjean, pied-noir, pas de problème non plus sauf qu'il ne tournait pas tout le temps parce qu'il buvait beaucoup de thé avec les gens : il était souvent assis ! (rires). Et Rémi AttaI, le preneur de son, pied-noir lui aussi... J'ai eu beaucoup de chance avec mon équipe, on a réussi en une semaine de tournage à entrer dans ce rythme et c'est également dû au respect que nous avions pour les gens.
Public : Comment avez-vous réussi à tourner tant d'images en si peu de temps ?
Eyal Sivan : Nous avons énormément tourné. On commençait à cinq heures du matin, à l'heure du réveil. Je voulais absolument un enfant qui se lave la figure. Alors, tous les jours, à cinq heures du matin, on cherchait... (rires). Il y a en tout onze heures de film et vingt à vingt-deux heures d'enregistrement son.
Public : C'est entièrement du documentaire pris sur le vif ou vous avez fait jouer certaines personnes ?
Eyal Sivan : Ah oui ! c'est du documentaire, complètement. Par exemple, la vieille femme qui porte son sac de farine, on ne le lui a pas donné ! (rires). Cette dame qui brode dans le film, on lui a demandé si on pouvait l'interviewer. Elle nous a donné son accord et on lui a dit de s'asseoir où elle voulait. Elle nous a répondu : "Non, je vais changer de robe." Nurith, le chef opérateur, a commencé à hurler : "Mais c'est pas raccord !" (rires). Mais c'est cette femme qui a décidé : elle ne voulait pas parler avec la robe qu'elle portait pour la distribution de nourriture. C'est elle qui s'est mis ce châle blanc sur la tête et s'est assise avec sa broderie. La même chose s'est produite avec l'homme dans la ferme, le cheik saoudien. Nous l'avons rencontré, il était par terre en train de faire des brochettes. II m'a dit : "D'accord pour l'interview, pas de problèmes, je vais me laver la figure." Et il est revenu habillé en cheik de sa propre volonté, on ne lui a rien demandé. De même pour la présentation. Ils commencent tous par : "Je m'appelle X ou Y et je viens de tel village." Avant l'interview et pendant que les camarades s'installaient, nous en parlions beaucoup avec eux et puis on leur disait : "C'est bon, vous pouvez commencer." Et ils se sont tous présentés de la même façon.
Public : Et le plan final avec le polaroïd ?
Eyal Sivan : Non, ce n'était pas préparé non plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais derrière cette femme, quelqu'un nettoie la rue. Après une projection, un spectateur a essayé de me convaincre qu'on avait reconstitué Aqabat Jaber et que l'homme derrière nettoyait le décor ! En fait, toutes les caméras étaient déjà rangées, tout était chargé sur les camions, c'était vraiment les derniers moments et nous étions sur le point de partir. Il restait une caméra pour filmer le marché juste avant le départ. En souvenir, j'ai pris des polaroïds, un de Halime -c'est le nom de cette femme- et la caméra filmait derrière moi. Cela a donné la scène de Halime, la seule qui ait touché la caméra et qui ait été avec nous pendant tout le tournage.
Statut : réfugié.
Public : J'ai eu l'impression en voyant votre film que ces gens étaient désespérés et dépressifs. Est-ce une impression exacte ?
Eyal Sivan : Je ne sais pas, il est très difficile de vous répondre. La seule chose que je puisse dire c'est que j'ai essayé d'être le plus honnête possible avec leur vie de tous les jours. S'il en ressort une image dépressive, c'est peut-être que leur vie l'est, mais moi je ne peux pas répondre. J'ai un grand amour pour ces gens, on a beaucoup rigolé ensemble le soir, ils ne sont pas dépressifs, ils sont passionnés aussi. Le film s'appelle Vie de passage parce que j'ai essayé de trouver un titre qui défroisse leur rythme de vie : entre la vie et la survie, il y a la "vie de passage."
Michèle Driguez : Ce statut de réfugié que leur ont donné le déplacement et l'exil leur impose un mode de vie très difficile. Mais je ne vois pas de résignation ni de désespoir chez ces gens parce que, comme le dit très bien l'un d'eux, le mot de "réfugié" est porteur en lui-même du retour obligatoire. Et c'est ce qui leur donne en même temps une force énorme et un énorme espoir, même si leur situation nous apparaît à nous comme désespérée ou désespérante...
Eyal Sivan : Je voudrais rajouter que même Aziz, le seul qui construise sa maison en dur, ne plantera pas de jardin autour. Il dit avoir perdu l'espoir de retour, mais il construit sa maison, non pas pour s'installer mais simplement parce qu'elle sera plus résistante, plus propre. Ils sont très attentifs, même politiquement. Fawaz Turki, un écrivain palestinien, raconte que lorsqu'il était enfant dans les camps du Liban, l'UNRWA décida de planter des arbres pour améliorer les camps ; la nuit, les enfants les déracinaient parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'impression de s'installer. Actuellement, le gouvernement israélien a un programme intitulé "Do it yourself" pour construire des maisons. Mais les réfugiés n'en veulent pas et cela pose un problème politique grave : que vont devenir ces réfugiés ? Leurs anciennes maisons sont maintenant sous l'autoroute Jérusalem-Tel-Aviv à soixante kilomètres d'Aqabat Jaber...
Comme une fête dans le désert...
Public : On imagine mal le fonctionnement du camp par rapport au monde extérieur : s'il est clos, s'il y a des filtrages policiers. On ne sent pas du tout présence israélienne...
Eyal Sivan : Pendant tout le tournage, il n'y en a pas eu. Pendant les repérages non plus. L'année israélienne n'entrait pas à Aqabat Jaber. Après le film, oui... Cinq cents mètres avant le camp, il y a un poste de contrôle mais nous n'avons jamais été fouillés, même les voitures immatriculées Cisjordanie.
Public : Pourriez-vous nous dire quels liens ces gens ont avec l'extérieur, avec les organisations palestiniennes par exemple, s'ils en ont ?
Eyal Sivan : Aqabat Jaber est isolé dans le désert. A trois kilomètres, il y a une assez grande ville palestinienne de Cisjordanie, Jéricho. Il y a très peu de jeunes à Aqabat Jaber. Certains travaillent à l'intérieur pour l'UNRWA, les autres travaillent à l'extérieur pour les Israéliens, quelques fois pour le gouvernement, ou dans les marchés à Jérusalem, comme ouvriers, etc. Ils ont donc des contacts : journaux, télévision, vous l'avez vu, mais ils n'arrivent pas toujours à capter la télévision israélienne. C'est plutôt la télévision jordanienne qu'ils reçoivent et ils ont donc des informations comme s'ils vivaient en Jordanie. Quant aux organisations palestiniennes, Aqabat Jaber n'est pas un "camp à émeutes", qui représente la résistance palestinienne ou la lutte contre la répression israélienne. Je donnerai un petit exemple. Il y a soixante camps de réfugiés palestiniens et on en connaît très peu. J'ai montré le film à des gens de l'O.L.P. qui ignoraient totalement l'existence d'Aqabat Jaber. C'est un camp qui a été oublié, même par la résistance palestinienne : on peut encore discuter avec des enfants sans qu'ils disent à la caméra : "Moi, je ne parle pas avec un journaliste si Arafat n'est pas là." Ce qui arrive très souvent à Bourj-EI-Barajnee, Sabra et Chatila, les camps du Liban évidemment. Mais en territoires occupés, il y a aussi des camps où, mis à part le discours politique, la discussion n'est plus possible avec les gens. Aqabat Jaber est une sorte d'île isolée.
Public : Pourquoi ?
Eyal Sivan : D'abord parce que c'est loin ; parce que tout le monde pense que c'est un camp complètement abandonné. La population y est plus âgée, il n'y a pas beaucoup d'enfants, les jeunes quittent le camp.
Public : Et où vont-ils ?
Eyal Sivan : Partout, dans les villes, vers le golfe Persique. Ils quittent carrément la Palestine, ils vont en Jordanie, ils réunissent leur famille de l'autre côté de la frontière, ils vont en prison...
Le poids des mois.
Public : Il y a un terme profondément politique qui apparaît à plusieurs reprises dans le film : celui de "citoyen". Le mot arabe "muwattan" n'est traduit que dans une seule de ses acceptions "patrie" alors qu'il signifie aussi "pays". Je ne sais pas si cela correspond à une censure ou à votre stratégie mais seul le mot "Etat" n'apparaît pas...
Eyal Sivan : Nous avons eu d'énormes problèmes de traduction. Ils parlent tous en dialecte, sauf une personne, le religieux, qui parle l'arabe littéraire. L'équipe de traduction était composée d'une Libanaise, d'un Palestinien qui habite en France et d'un Palestinien de l'intérieur, originaire de Galilée. Nous aurions pu faire un film sur toutes les discussions que nous avons eues pour la traduction. Un des grands problèmes tourne autour du mélange très intéressant qui existe entre les mots "terre", "patrie", "Etat". Il s'agissait de savoir quand ils disaient quoi... Autre cas problématique auquel nous avons été confrontés : disent-ils "J'ai fui mon village" ou "j'ai été chassé de mon village" ? Car la traduction littérale du mot qu'ils emploient est : "Je suis sorti de mon village". Cela ne relève pas du tout de la censure. Mais le mot "Etat" n'existe pas ; les notions de "patrie", de "citoyen", oui. Et c'est intéressant car des Africains qui ont vu le film m'ont raconté qu'au Zaïre par exemple, quand ils saluent quelqu'un, ils sont obligés de dire : "Bonjour, citoyen." Dans d'autres pays africains, on dit : "Bonjour, patriote." Les Palestiniens aiment beaucoup utiliser le mot "citoyen" car c'est l'inverse du concept de "réfugié".
Public : Si l'on utilise le mot "citoyen" dans l'acception universelle du terme, il est impossible de concevoir la citoyenneté sans Etat.
Eyal Sivan : Prenez les phrases où apparaît le mot. Dans certains cas, on oppose le terme "fellah" (agriculteur) à celui de "citoyen" (citadin). Ailleurs, le bédouin dit : "Je suis citoyen israélien, j'ai la carte d'identité israélienne." Le terme "citoyen" est donc associé soit à l'Etat israélien soit au statut de fellah ou de réfugié.
Public : Pour en rester à ces problèmes de traduction, pourquoi lorsque dans le texte arabe apparaît le mot "Allah", on le traduit en français par "Allah" ? Quand un Anglais prie, il invoque "God" ; dira-t-on qu'il prie "God" ? Un Arabe prie Allah parce que Dieu en arabe se dit "Allah"...
Eyal Sivan : Je me suis posé la question à plusieurs reprises et c'est un musulman qui m'a répondu : "Et comment traduit-tu "lnch'AlIah" ? "Inch'a God" ? (rires).
Michel Ciment : La différence c'est que "God" en anglais a la même signification que "Dieu" en français. Je suppose que si des Hindous traduisaient, ils garderaient le mot "God" parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Je sais bien que la religion musulmane est monothéiste et qu'il y a donc une différence entre musulman et hindou. Et puis c'est aussi une question de respect de la différence.
Eyal Sivan : Pour moi, c'est effectivement un respect culturel. Mettre dans la bouche d'un musulman qui dit "Ya Allah !", "Oh ! my God", ça n'a pas de sens ! (rires).
Quelles réalités et quelles images ?
Public : Ne confortez-vous pas le public occidental dans l'image qu'il a des Arabes : des gamins partout, des hommes oisifs qui passent leur temps à fumer le narghilé, etc. ? Les Palestiniens sont l'intelligentsia du monde arabe, ce sont des fonceurs et on ne voit pas cette image dans votre film.
Eyal Sivan : D'abord, je ne vois pas grand mal à fumer narghilé et à avoir beaucoup de gamins ! (rires). Ça se discute ! Sinon, J'ai décidé de devenir Dieu pour traiter tous les sujets…(rires). L'intelligentsia palestinienne est un sujet passionnant, mais c'est tout autre chose. Des gens m'ont aussi reproché de n'avoir montré que des Arabes : "Vous ne pouviez pas montrer un lsraélien au moins, au début ou à la fin, un seul ?…" (rires). La prochaine fois, je ne montrerai peut-être que des Israéliens... Il y a énormément de choses à montrer, on est exposé à des milliers d'images. Quand je montre ce camp sans armée, sans police, je ne dis pas que c'est l'image de la Cisjordanie, c'est celle d'Aqabat Jaber. La Cisjordanie, on la voit à la télévision. A Gaza, c'est autre chose. En Galilée, c'est encore un autre problème et vous le verrez abordé dans Noce en Galilée, le film de Michel Khleifi. Ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a pas assez de films pour montrer toutes ces réalités. En Israël, à la télévision, on voit toujours les mêmes images : des gamins qui jettent des pierres et des soldats israéliens qui tabassent des Arabes et qui tirent sur des manifestants. C'est une autre image : ils ne fument pas le narghilé et ils font des enfants pour qu'ils jettent des pierres. Le public israélien a été étonné en voyant dans mon film que les Palestiniens ne passent pas leurs journées à brûler des pneus ou à jeter des pierres.
Entretien réalisé par Michèle Driguez et Henri Talvat, le 2 novembre 1987.
Espace, temps et mouvement :
trinité méditerranéenne...
Michèle Driguez : Dans le cinéma méditerranéen, les notions d'espace, de temps et de déplacement sont fondamentales : un espace ouvert à tous les voyages, à tous les départs et en même temps, un espace clos autour duquel on tourne, en se déplaçant tout le temps. Ces notions-là sont au cœur de Aqabat Jaber, elles élaborent toute une problématique sur l'enfermement, l'impossibilité du déplacement, l'immobilisation forcée, même celle du bédouin, du nomade, qui est l'incarnation de la circulation. J'aimerais que tu nous parles de cette problématique et de ce qu'elle représente pour toi comme cinéaste et Méditerranéen.
Eyal Sivan : Nous, Israéliens, avec notre héritage, nous sommes étrangers en Méditerranée. Nous nous sommes implantés là-bas poussés par une sorte de hasard historique. Mais apparaît tout d'un coup une nouvelle génération qui est née là-bas et qui, à cause de raisons politiques, ne peut pas s'intégrer en Méditerranée. Il y a des choses qui sont là, que l'on regarde le plus souvent, dans le rejet et on essaye de développer une sensibilité. C'est là que j'entre en tant que cinéaste, comme Israélien qui regarde ou qui essaye d'avoir un esprit ouvert.
Une chose qui m'a énormément intéressé par exemple c'est le problème des racines, de la terre, un problème très profond qui connaît de très nombreuses étapes ; qui commence avec les Palestiniens comme peuple, nous Israéliens comme peuple d'occupants mais aussi comme peuple qui revient ; à l'intérieur, cette culture musulmane qui existe chez les Palestiniens, le débat éternel entre sédentaires et nomades. J'ai essayé d'utiliser les bédouins, ces hommes qui possèdent une grande liberté de déplacement comme contrepoint à ces sédentaires déracinés qui ont été déplacés en force : les nomades qui se déplacent volontairement, par un besoin d'air et d'espace et les sédentaires déplacés. Avec évidemment toutes les déformations sociales que subissent les bédouins qui habitent Aqabat Jaber : ils se retrouvent tout d'un coup dans un camp de réfugiés qui est un symbole d'enfermement dans toutes les cultures (il y a aujourd'hui douze millions de réfugiés dans le monde, c'est une population énorme). Le bédouin le dit lui-même : "Je suis venu à Aqabat Jaber parce que d'ici, j'espère retourner chez moi." Il est israélien, il a un passeport israélien, mais il ne peut plus se déplacer en Méditerranée, il ne peut plus faire les grands voyages bédouins des déserts de l'Arabie à travers l'Egypte, en remontant vers la Jordanie, la Syrie, la Palestine… Tout cela lui est devenu impossible à cause des états, des frontières, et il s'enferme dans un camp de réfugiés pour trouver sa liberté. Comme il le dit très bien : "Je suis à l'intérieur, ma tente est pliée, mais je suis bédouin." Ça, c'est quelque chose d'essentiel.
Prenons l'exemple des Juifs Sépharades qui ont eu d'énormes problèmes, qui étaient eux aussi enfermés dans une culture européenne ashkénaze à l'intérieur d'Israël et qui ont réussi en Israël à installer leur "chez moi" comme dit Michel Khleifi dans les Actes des 8es Rencontres : C'est vrai que nous, Ashkénazes, sommes les bâtards de la Méditerranée car en Pologne, on n'a pas connu la mer, on a peur de la mer. On a construit Tel-Aviv en totale contradiction avec la Méditerranée, très étroite sur la mer et très longue vers l'intérieur. A travers toutes ces histoires de déplacements et de racines, j'ai essayé de traiter les attaches palestiniennes à cette terre : pourquoi les Palestiniens disent "ma terre", pourquoi parlent-ils de retour : de quoi parlent-ils, d'où cela vient-il et où peut s'instaurer le dialogue ? Moi, en tant qu'Israélien, je comprends ce que cela signifie : j'habite Paris depuis deux ans. Ces problèmes de déplacement sont fondamentaux d'autant qu'on débouche sur des concepts nouveaux comme Etat, passeport, visa : les Israéliens aujourd'hui sont comme dans une île...
Michèle Driguez : d'est pour cela que Aqabat Jaber est une confirmation de toutes nos hypothèses sur la Méditerranée, car il existe des liens très étroits entre d'une part l'espace concret, physique, géographique de la Méditerranée et l'espace cinématographique qui le représente, et d'autre part entre ces problèmes de terre, de racines et le temps. Que se passe-t-il pour des populations déplacées comme le sont beaucoup de populations méditerranéennes qui connaissent l'exil, la diaspora, etc. ? Lorsqu'elles perdent leurs racines, c'est-à-dire l'inscription dans l'espace concret, la terre, une sorte de glissement, de déplacement s'opère vers la création d'un espace imaginaire, mythique, qui lui, est fortement inscrit dans le temps avec toute la dimension du souvenir, de la mémoire, de la tradition qui se perpétue... C'est un type de problématique qui est propre à toutes les diasporas, méditerranéennes ou non, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée dans Aqabat Jaber.
Les mythes sont-ils menteurs ?
Eyal Sivan : Oui, c'est vrai et je veux ajouter là-dessus quelque chose qui me semble important. J'ai eu après le film beaucoup de réactions de la part d'Israéliens (mais pour moi ce sont des réactions juives avant tout, plus qu'israéliennes, liées à un territoire...) ; ils me demandaient : "C'est vrai que dans leurs villages il y avait des oranges et des citrons, que c'était de véritables paradis ?" Avec souvent cette réponse : "C'est vrai qu'en Terre Promise, il y avait des fleuves de miel et de Iait". L'aspect véridique de la mémoire n'est vraiment pas important. Ce qui importe le plus c'est la reconstruction de cette mémoire qui devient la vérité et on sent la force de ces gens qui font un rêve mythique... Mais je ne peux pas dire si c'était vraiment comme ça.
Henri Talvat : Mais ne crois-tu pas que c'est un peu normal ? Car dans ces pays arides, très désertiques, le mythe est forcément une exagération, une amplification : pour que le mythe soit vrai, il faut qu'il soit exagéré, qu'il y ait des fleuves de miel, etc. Sinon le mythe ne serait pas crédible. Si l'on disait : "Nous irons dans un endroit où il y aura un petit ruisseau", évidemment les gens répondraient : "Mais pour quoi faire ?" (rires).
Eyal Sivan : Oui, mais je ne pense pas que ce soit un mythe exagéré : c'est une autre façon de penser, un autre rythme. Quand un Méditerranéen parle, en Espagne, en Grèce, en Turquie, en ltaIie, il parle fort et beaucoup, il se répète dix mille fois, beaucoup de mots, de couleurs, on crie dans la rue, on parle avec les mains : ça fait partie d'une autre construction, d'une culture et c'est ça qui est vrai. Je ne pense pas que c'est le mythe simple : "J'ai perdu quelque chose alors je le reconstruis imaginairement plus grand." Non, ça fait partie de cette culture. Lorsque ces gens dans leurs villages parlaient avec leurs voisins, ils racontaient : "Moi cette année, j'ai eu une tonne d'oranges de plus que l'an passé." Qui va compter ? Qui va peser ? Evidemment le malheur palestinien entraîne une exagération qui est illustrée en plus par des éléments très concrets comme cet homme qui dit : "Les oranges sont chères, on les a envoyées par la mer." Il voit grand ! Mahmoud Darwich, le poète palestinien, écrit sur les terres, les oliviers, les villages et je suis persuadé qu'il y a cinquante, soixante, soixante-dix ans, quand un villageois partait de Jaffa pour la Galilée, quand il arrivait, il racontait les mêmes choses.
Henri Talvat : Au fond, surtout dans cette partie de la Méditerranée, les déplacements ne sont pas énormes, ce sont de petits déplacements et c'est une chose qui nous a toujours frappés. Si on le situe au niveau de la Méditerranée et à plus forte raison au niveau du monde, dans cette région-là en particulier, les déplacements sont tout petits. On parle de grands voyages, mais en fait c'était réduit, on allait d'une ville à l'autre. Cette notion de "petit déplacement" nous intéresse beaucoup.
Michèle Driguez : Et reliée à cette notion, en compensation, une surreprésentation de tout ce qui touche à la reconstruction imaginaire.
Eyal Sivan : C'est vrai, les déplacements sur cette rive de la Méditerranée sont petits. C'est lié aussi à une époque, une mémoire qui existent encore. Lorsqu'on voyageait de Jaffa à Haïfa qui étaient deux grandes villes palestiniennes, ça prenait énormément de temps. Les pèlerinages aussi étaient une aventure énorme. Mais je pense que ça devient une exagération parce que les déplacements de ce côté de la Méditerranée sont liés aux catastrophes. Les déplacements des Palestiniens ne sont pas uniquement physiques, de cent ou trois cents kilomètres : ils sont liés à des catastrophes, à une guerre, à des morts, à une peine profonde, énorme, où on laisse tout derrière soi. Ce n'est pas un déplacement choisi. Et lorsque ça arrive, ça devient très grand, une immense catastrophe.
Michèle Driguez : La catastrophe, c'est aussi la perte de l'identité.
Eyal Sivan : Oui ! C'est la perte de tout. Et quand on perd des choses, elles deviennent lointaines et en s'éloignant, elles deviennent beaucoup plus grandes. Nous sommes des gens qui exagèrent, nous avons le noir et le blanc tout de suite, mais on ne garde pas énormément de choses dans le gris. Je pense qu'en Méditerranée, les distances comme les génération
Du 31 octobre au 8 novembre 1987