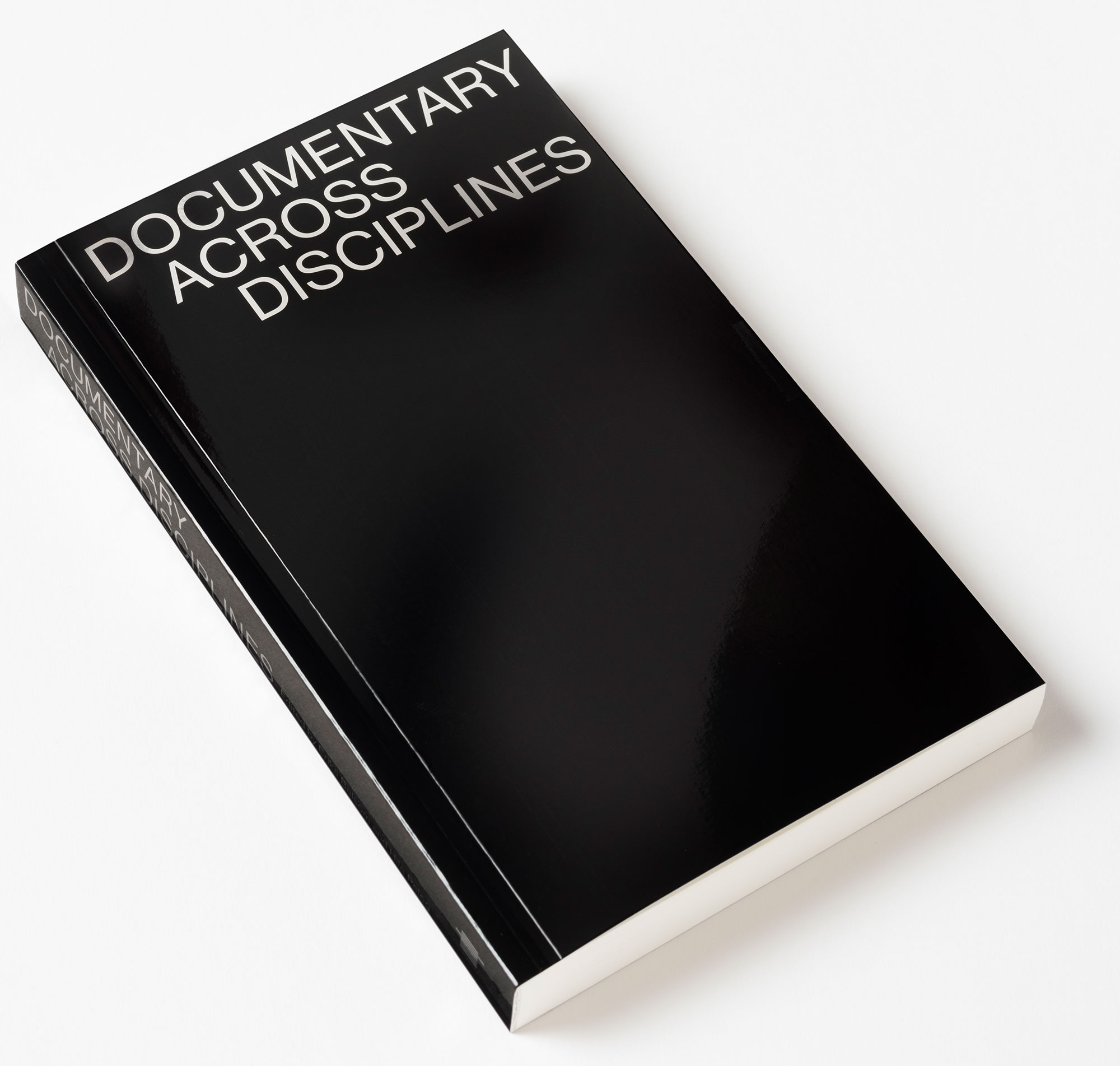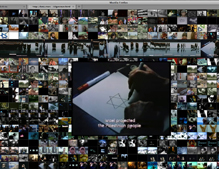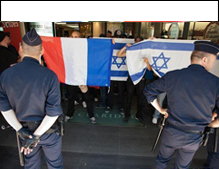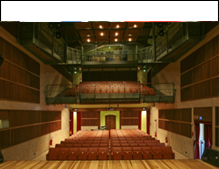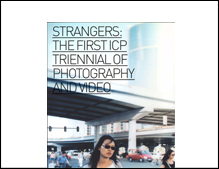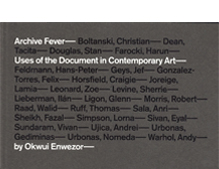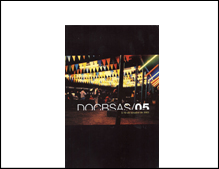-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
JERUSALEM. Au cours de ce 4e Festival du film, Eyal Sivan, réalisateur Israélien du très beau documentaire “Aqabat Jaber”, sur la vie d'un camp palestinien non loin de Jéricho, est retourné sur les lieux du tournage. Pour une projection dans la salle des fêtes. Emotions des réfugiés.
Quand j'arrive, le 30 juin au quatrième festival de Jérusalem, la fête bat son plein, depuis plusieurs jours, aux invités, Nagisha Oshima, Marcello Mastroiani, Krysztof Zanussi, Delphine Seyrig, Marta Meszaros, Claire Dewaere… on a donné un petit badge : Jérusalem in film festival - hundred films in one week. Who needs it ?! Entre un tour de la vieille ville, une escapade à Tel-Aviv ou Massada, on peut voir l’une des meilleures sélections de films d’auteurs récoltés dans les festivals et marché du film de l’année. Israël se flatte d’être le pays du monde où l’on voit le plus de films par tête de pipe, où en raison de la carence des distributeurs, la cinéphilie passe obligatoirement par les cinémathèques : celle de Haïfa, la plus ancienne, celle de Tel-Aviv la plus estudiantine, de Jérusalem, la plus belle.
A mon arrivée, on me met immédiatement au parfum. Profitant de sa présence au festival, Eyal Sivan, réalisateur du film Aqabat Jaber - prix du cinéma du réel 1987 - retourne sur les lieux du crime c’est-à-dire dans le camp de réfugiés palestiniens au sud de Jéricho où il a tourné son beau documentaire. Pour la première fois, le film va être projeté aux habitants d’Aqabat Jaber.
A 17 heures, le 2 juillet, je retrouve Eyal Sivan à la cinémathèque et nous partons ensemble pour Jéricho. Eyal, qui n’a guère plus de 25 ans, vit à Paris depuis trois ans. “En tant qu’israélien je me sentais obligé de faire ce film, dit-il. J’étais photographe de mode et j’ai découvert Aqabat Jaber en faisant des photos avec un modèle Je ne savais pas à l’époque qu’il y avait des gens qui habitaient là. Dans mon film, j’ai voulu leur donner la parole, tout simplement.”
Quittant les riantes collines de Jérusalem, notre voiture s’engage dans un désert aride, des cônes de limon desséché et de pierrailles où de temps en temps on découvre une tente de bédouins et quelques maigres animaux. La chaleur monte, devient presque suffocante. Enfin nous voilà dans le camp, une immense cour qui s’ouvre sur des bâtiments aux toits bas. On nous fait immédiatement asseoir dans une petite pièce où Rashid Areikat, le responsable palestinien de l'UNRWA (Office des Nations unies pour le Secours aux réfugiés palestiniens) fait les présentations : “faites comme vous voulez, ici nous n’avons rien à cacher”, dit-il aux journalistes de télévision.
Eyal Sivan, immédiatement entouré, serre des mains échange des saluts. Autour de nous, des hommes des vieillards des petits garçons aux yeux pétillants. “Je voudrais bien que les femmes puissent voir la projection au moins celles qui sont dans le film, dit le cinéaste. Elles ne viendront pas, lui réponds-on. Tous ces étrangers ces photographes, c’est trop pour elles.”
La projection a lieu dans la salle des fêtes, dans une chaleur d’environ 40 degrés, en dépits de quelques ventilateurs accrochés au plafond. Le son est assez horrible, à la fois criard et difficilement audible. “Je parle arabe, me dit le correspondant du monde et je n’y comprends rien.”
Des journalistes impatients quittent la salle après quelques prises de vue, sans voir le film. Je I’ai visionné la veille à la cinémathèque et me concentre sur les réactions du public. Juste derrière moi une rangée d'hommes - deux, en costume traditionnel, un voile de laine blanche sur la tête les autres habillés à l'occidentale - n’en perdent pas une miette. J'attends avec impatience et un peu d'appréhension le moment où Djamal, un jeune homme né à Aqabat Jaber, dit à la Caméra : “Si nous avions des armes, nous n’hésiterions pas à nous battre pour nos droits”. Cette déclaration est accueillie comme les autres : un sourire de reconnaissance mais sans démonstration particulière. Ce n’est qu'une des choses que l'on se dit, tous les jours à Aqabat Jaber comme “la terre c’est l’âme de l’homme” ou “Dans mon village, on faisait un bon repas rien qu’en trempant son pain dans du jus d’orange”.
A la fin de la projection, de petits groupes se forment dans la cour, à l'initiative des paIestiniens qui parlent l'anglais. Imad, prof de sciences nat’ dans les camps de réfugiés, m'interpellent : “Que pensez-vous du film ?”
“C'est plutôt à moi de vous demander cela.”
“C’est un film qui montre vraiment la réalité, notre réalité quotidienne. Les palestiniens ont mauvaise presse, à cause du terrorisme. C’est important de montrer qui nous sommes vraiment, de quoi notre vie de tous les jours est faite. Nous ne sommes pas des hommes politiques. Nous sommes des paysans privés de leur terre.”
“Il faut que je vous pose une question un peu dure : Tous ceux qui parlent dans le film (sauf un) n’arrêtent pas de dire que leur vie dans le camp est provisoire, qu’ils n’ont qu’un désir, retourner dans les villages où leurs parents sont enterrés, retourner cultiver la terre qui leur appartient. Mais ces villages n’existent plus, vous le savez. Ils ont été enterrés sous l’autoroute Jérusalem Tel-Aviv. Ils ont disparu sans laisser de traces. Que voulez-vous alors ?”
Imad est formel : “Nous voulons vivre en paix. Nous sommes des hommes religieux, des hommes de paix. La Palestine est une terre sainte pour tout le monde. Il faudrait en faire une zone internationale où tout le monde ait le droit de vivre. De vivre en paix.” Et comment pense-t-il pouvoir faire entendre sa voix, et celles des autres réfugiés qui pensent comme lui ? “Je n’ai pas le droit de m’exprimer en public. Je n’ai pas de député, je n’ai pas de gouvernement, je n’ai pas de carte d’électeur, juste une carte d’identité. Je vis sur une terre qui ne m’appartient pas…”
Les conversations se proIongent. Eyal est très sollicité, J'apprends que quand il est arrivé pour tourner dans le camp, les habitants d’Aqabat Jaber ne savaient pas qu’il était israélien, Djamal s'en est rendu compte au bout de trois jours, mais il a décidé de continuer comme si de rien n'était. Eyal est invité à passer la nuit au camp, signe d’hospitalité suprême. Nous rentrons en sherout (taxi collectif) à la cinémathèque.
Le lendemain certains journaux israéliens rendront compte de l’évènement. En général, la réaction au film est plutôt mitigée - sauf au festival où le public est enthousiaste. Une phrase du film me revient, lancinante, car elle résume bien la cruauté de l’impasse palestinienne : “La terre nous appartient. On ne peut jamais l’abandonner. Même après des millions d’années, ça sera toujours notre terre.” C’est un Palestinien déraciné qui a dit ça. Mais ça pourrait presque être un slogan sioniste… En attendant, à Aqabat Jaber, trois mille réfugiés se partagent quelques maigres points d'eau, survivent sur les rations de l’ONU et rêvent d’orangeraies à jamais disparues.
Bérénice REYNAUD