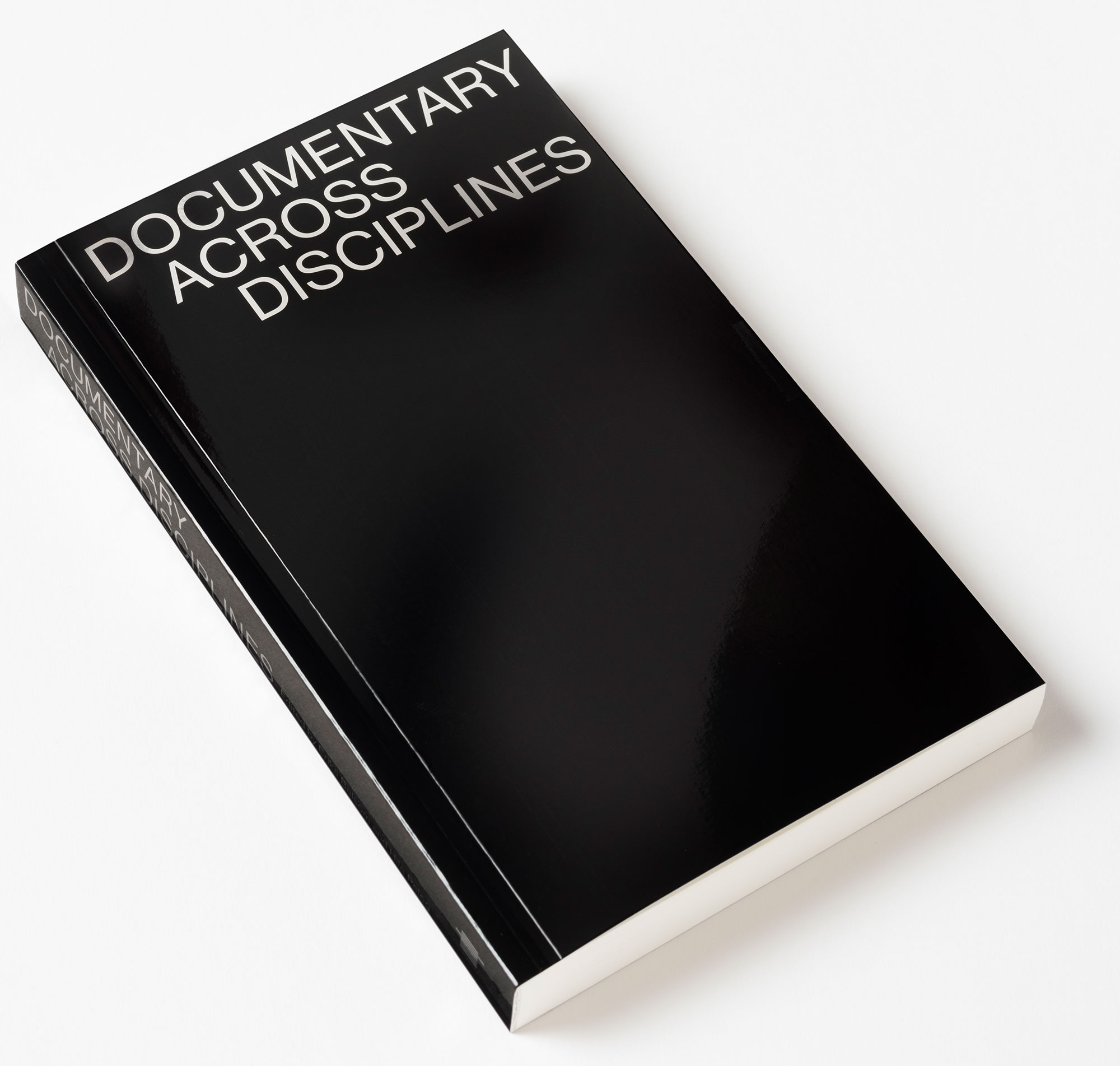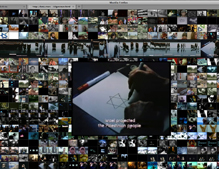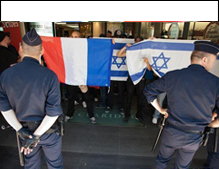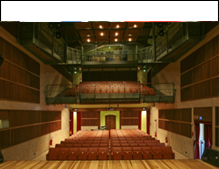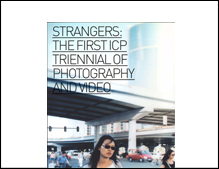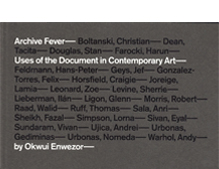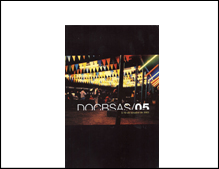-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
press
La ville fantôme (Les cahiers du cinéma)
01.04.1987
Aqabat Jaber, d’Eyal Sivan, montre lui aussi la conscience des réfugiés du Proche-Orient, même si celle-ci joue de ruses pour tenter encore de sauver l’honneur. Agressivité face à la caméra, mythomanie, sermons, autant de refuges lorsque le réel est insupportable. Il y a, dans le film d’Eyal Sivan, une conscience aiguë du regard de la caméra de la part de tous ceux qu’elle filme. Loin de la gommer, le réalisateur la conserve pour en exploiter la richesse. “Laisse-toi filmer, allons en Occident !”, lance sous forme de boutade une femme du camp à son enfant. D’autres habitants ont un langage plus brutal face à l’œil étranger, au point de le chasser à coups de pierre. Si cette présence est sans arrêt évoquée plus ou moins explicitement, c’est qu’elle pointe une réalité inacceptable : celle que vivent les 2.500 réfugiés d’un camp qui en compte, au début des années 1950, 65.000. La plupart ont été chassés de Palestine en 1948 et vivent ou survivent dans cette ville fantôme, dans ce lieu qu’ils refusent de s’approprier car il ne peut être que de transit. Voilà pourquoi tout ici est bâti de bric et de broc, très bien filmé en de lents panoramiques sur les toits de zinc, les murs qui s’effondrent, les sacs de jute qui s’effilochent. Ici, chacun a adapté son discours pour nier l’évidence, celle qui prétend que le village auquel ils espèrent tous retourner, leur terre, celle de leur ancêtre, n’est plus que ruine. Eyal Sivan met bien en évidence ce qui sépare ce langage sur un hypothétique retour de cet état d’installation qui se tisse, avec ses conflits de voisinage, ses rivalités, ses autorités. La soif, la survie, la mort lente, inexorable sont les règles de ce village de réfugiés où pourtant des enfants naissent, jouent et retournent avec ironie la question au cinéaste : “Dites-nous, vous, ce qu’est un réfugié !” Les longs plans fixes, le montage parallèle, le village à toutes les heures du jour et de la nuit sont autant de contrepoints du quotidien aux mots, aux discours, et laissent à chacun son rythme, son temps, son refuge pour échapper à l’insupportable, au réel. C’est en filmant demi-conscience de l’être - celle du Japonais qui s’étonne d’avoir survécu à son opération suicide et de retrouver goût à la vie, celle du Palestinien qui se dit sur le point de partir et consolide sa maison avec une truelle et un peu de ciment - que le documentaire prend sa force. Parce qu’il révèle, en juxtaposant comportements et discours, la complexité de l’être. Celle que le temps lui a peu à peu révélée, plus ou moins crûment. Cette démarche-là ne se bâtit pas que sur l’empirisme, l’intuition du tournage, la construction, à posteriori, du montage. Elle implique une pré-conscience du sujet qui lui permet de ne pas se laisser happer par le rythme, le discours de l’autre, mais de juxtaposer le point de vue extérieur à celui du réalisateur quitte à les confronter, jusqu’à l’hostilité. C’est de cette friction-là que naissent la cohérence et la continuité du vrai.