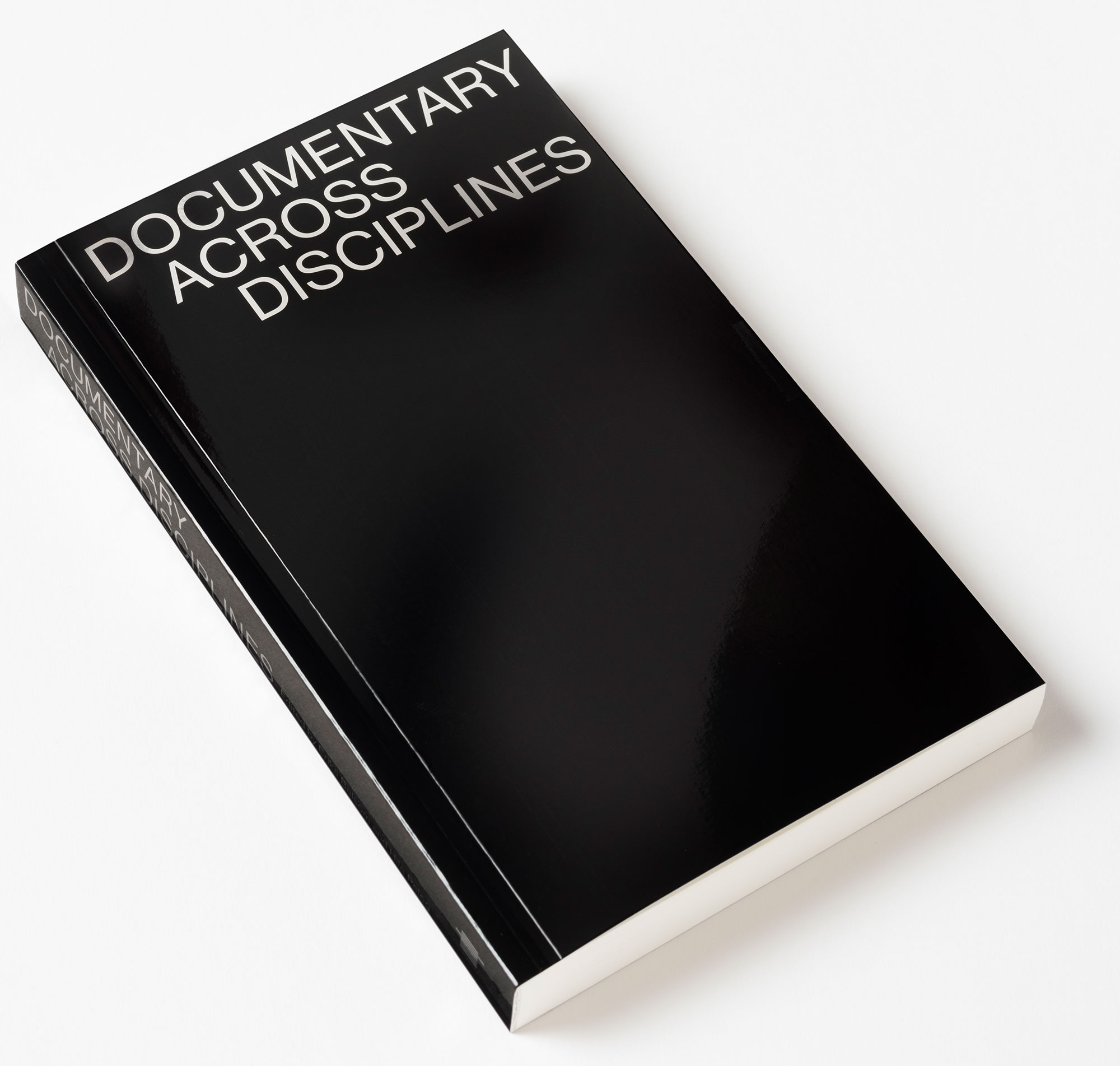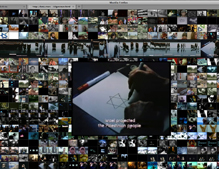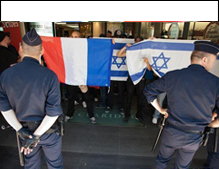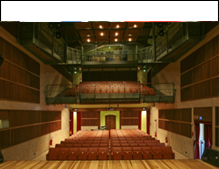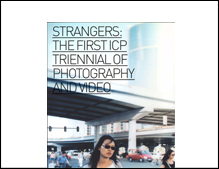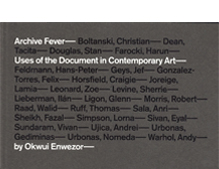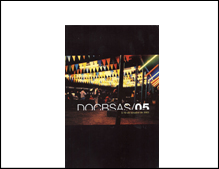-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
interviews
Je ne suis pas un pacifiste, Interview by Pablo Chimienti [Le Quotidien]
20.06.2008
Le réalisateur juif israélien Eyal Sivan est un fervent défenseur de la cause palestinienne. Il explique son combat culturel pour le respect du peuple palestinien.
Eyal Sivan passe son enfance à Jérusalem, devient photographe à Tel-Aviv, puis rejoint la France en 1985 où il devient réalisateur de documentaires. Il a depuis sorti une quinzaine de films qui lui ont valu de nombreuses distinctions et quelques déboires avec une partie de ses compatriotes ou coreligionnaires.
Qu'est-ce qui vous amène au Luxembourg?
Il se trouve qu'une des associations de solidarité avec la Palestine a organisé un minifestival de films à l'occasion du 60e anniversaire de l'État d'Israël et le 60e anniversaire de la «naqba», c'est-à-dire la destruction de la Palestine en 1948. Parmi ces films, ils montrent deux de mes documentaires - dont mon premier film qui a gagné le prix Cinéma du réel à Paris - ce qui me fait vraiment plaisir. Alors, je suis venu parce que dans le milieu du documentaire, ces associations, qu'elles soient politiques ou culturelles, restent encore le mode de diffusion principal des oeuvres.
C'est donc, contrairement à la fiction, la meilleure façon de faire vivre les documentaires?
C'est l'histoire du documentaire! Un cinéma et un moyen d'expression culturel, extrêmement proche des gens. Les gens viennent en voir, souvent à cause des sujets traités et ce n'est pas seulement une consommation culturelle. Ça reste un acte culturel, où on discute et où on réfléchit.
C'est pour ça que la présence du réalisateur est importante?
Oui, je crois!
Et pour vous, c'est important aussi de rencontrer votre public?
Bien sûr. C'est ce qui fait que le documentaire se situe quelque part entre le cinéma de fiction et le théâtre. On est face au public! On le voit. Et on voit aussi à quel point les gens sont assoiffés de documentaires. Et de plus en plus, puisqu'il a disparu des écrans de télévision.
Pouvez-vous nous présenter vos deux films projetés ce soir (NDLR : hier soir) : Aqabat Jaber - Vie depassage et Aqabat-Jaber - Paix sansretour?
Oui, les deux films choisis ont été tournés dans le même camp de réfugiés palestinien, Aqabat-Jaber, dans la vallée de la mer Morte, à côté de Jéricho. Un camp dont on ne parle pas beaucoup dans les médias. En 86, quand j'étais encore jeune, ça faisait un an que j'étais en France, et j'ai fait ce film qui raconte une journée dans la vie d'un camp de réfugiés palestiniens. En tant qu'Israélien qui a appris l'appartenance à la terre d'Israël, je me suis intéressé à une appartenance qui n'est pas apprise,mais innée. Ce sont des paysans qui ont été déracinés dans le cadre d'un nettoyage ethnique de la Palestine que mes aïeuls ont commis. Sept ans plus tard, il y a eu les accords d'Oslo pour le processus de paix. Je suis donc retourné à ce camp de réfugiés qui se trouvait dans la première zone évacuée par l'armée israélienne. Je me suis intéressé alors à la question d'être réfugié, dans le cadre d'un règlement politique dans lequel les réfugiés ne peuvent pas rentrer chez eux. Je me suis alors posé la question, qui est la titre du film, "Paix sans retour?" Les deux films traitent, pour moi, du sujet le plus important et le plus compliqué qui est la question des réfugiés palestiniens, c'est-à-dire la source du conflit israélo-palestinien. Qui est toujours d'actualité et toujours laissé de côté!
Comment réagit le public par rapport à vos films, surtout dans votre pays?
Je suis très très bien vu dans certains milieux de mon pays et très très mal vu dans d'autres. Je suis un opposant depuis plus de 20 ans de la politique israélienne, je me situe dans l'opposition culturelle et politique, je me situe dans la solidarité avec la lutte palestinienne, et quand je dis lutte, c'est dans l'inspiration de la transformation de ce territoire que certains appellent Israël et d'autres Palestine. Pas dans la lutte armée, quoi! Je ne suis pas un pacifiste. La majorité de mes compatriotes sont pour la lutte armée, puisqu'ils la font. À partir de là, je ne vois pas pourquoi les Palestiniens n'auraient pas droit à la lutte armée aussi! Même si je pense que ce n'est pas le moyen le plus efficace. Ma lutte est une lutte pédagogique, une lutte culturelle, mais pour reparler du public, je pense qu'il aime qu'on le respecte. Et ça, dans le milieu culturel on a tendance à l'oublier.
C'est-à-dire?
Le public n'est pas une bande de consommateurs, de veaux à qui il faut dire quoi penser. Il faut, au contraire, leur proposer des sujets de pensée.
Eyal Sivan passe son enfance à Jérusalem, devient photographe à Tel-Aviv, puis rejoint la France en 1985 où il devient réalisateur de documentaires. Il a depuis sorti une quinzaine de films qui lui ont valu de nombreuses distinctions et quelques déboires avec une partie de ses compatriotes ou coreligionnaires.
Qu'est-ce qui vous amène au Luxembourg?
Il se trouve qu'une des associations de solidarité avec la Palestine a organisé un minifestival de films à l'occasion du 60e anniversaire de l'État d'Israël et le 60e anniversaire de la «naqba», c'est-à-dire la destruction de la Palestine en 1948. Parmi ces films, ils montrent deux de mes documentaires - dont mon premier film qui a gagné le prix Cinéma du réel à Paris - ce qui me fait vraiment plaisir. Alors, je suis venu parce que dans le milieu du documentaire, ces associations, qu'elles soient politiques ou culturelles, restent encore le mode de diffusion principal des oeuvres.
C'est donc, contrairement à la fiction, la meilleure façon de faire vivre les documentaires?
C'est l'histoire du documentaire! Un cinéma et un moyen d'expression culturel, extrêmement proche des gens. Les gens viennent en voir, souvent à cause des sujets traités et ce n'est pas seulement une consommation culturelle. Ça reste un acte culturel, où on discute et où on réfléchit.
C'est pour ça que la présence du réalisateur est importante?
Oui, je crois!
Et pour vous, c'est important aussi de rencontrer votre public?
Bien sûr. C'est ce qui fait que le documentaire se situe quelque part entre le cinéma de fiction et le théâtre. On est face au public! On le voit. Et on voit aussi à quel point les gens sont assoiffés de documentaires. Et de plus en plus, puisqu'il a disparu des écrans de télévision.
Pouvez-vous nous présenter vos deux films projetés ce soir (NDLR : hier soir) : Aqabat Jaber - Vie depassage et Aqabat-Jaber - Paix sansretour?
Oui, les deux films choisis ont été tournés dans le même camp de réfugiés palestinien, Aqabat-Jaber, dans la vallée de la mer Morte, à côté de Jéricho. Un camp dont on ne parle pas beaucoup dans les médias. En 86, quand j'étais encore jeune, ça faisait un an que j'étais en France, et j'ai fait ce film qui raconte une journée dans la vie d'un camp de réfugiés palestiniens. En tant qu'Israélien qui a appris l'appartenance à la terre d'Israël, je me suis intéressé à une appartenance qui n'est pas apprise,mais innée. Ce sont des paysans qui ont été déracinés dans le cadre d'un nettoyage ethnique de la Palestine que mes aïeuls ont commis. Sept ans plus tard, il y a eu les accords d'Oslo pour le processus de paix. Je suis donc retourné à ce camp de réfugiés qui se trouvait dans la première zone évacuée par l'armée israélienne. Je me suis intéressé alors à la question d'être réfugié, dans le cadre d'un règlement politique dans lequel les réfugiés ne peuvent pas rentrer chez eux. Je me suis alors posé la question, qui est la titre du film, "Paix sans retour?" Les deux films traitent, pour moi, du sujet le plus important et le plus compliqué qui est la question des réfugiés palestiniens, c'est-à-dire la source du conflit israélo-palestinien. Qui est toujours d'actualité et toujours laissé de côté!
Comment réagit le public par rapport à vos films, surtout dans votre pays?
Je suis très très bien vu dans certains milieux de mon pays et très très mal vu dans d'autres. Je suis un opposant depuis plus de 20 ans de la politique israélienne, je me situe dans l'opposition culturelle et politique, je me situe dans la solidarité avec la lutte palestinienne, et quand je dis lutte, c'est dans l'inspiration de la transformation de ce territoire que certains appellent Israël et d'autres Palestine. Pas dans la lutte armée, quoi! Je ne suis pas un pacifiste. La majorité de mes compatriotes sont pour la lutte armée, puisqu'ils la font. À partir de là, je ne vois pas pourquoi les Palestiniens n'auraient pas droit à la lutte armée aussi! Même si je pense que ce n'est pas le moyen le plus efficace. Ma lutte est une lutte pédagogique, une lutte culturelle, mais pour reparler du public, je pense qu'il aime qu'on le respecte. Et ça, dans le milieu culturel on a tendance à l'oublier.
C'est-à-dire?
Le public n'est pas une bande de consommateurs, de veaux à qui il faut dire quoi penser. Il faut, au contraire, leur proposer des sujets de pensée.