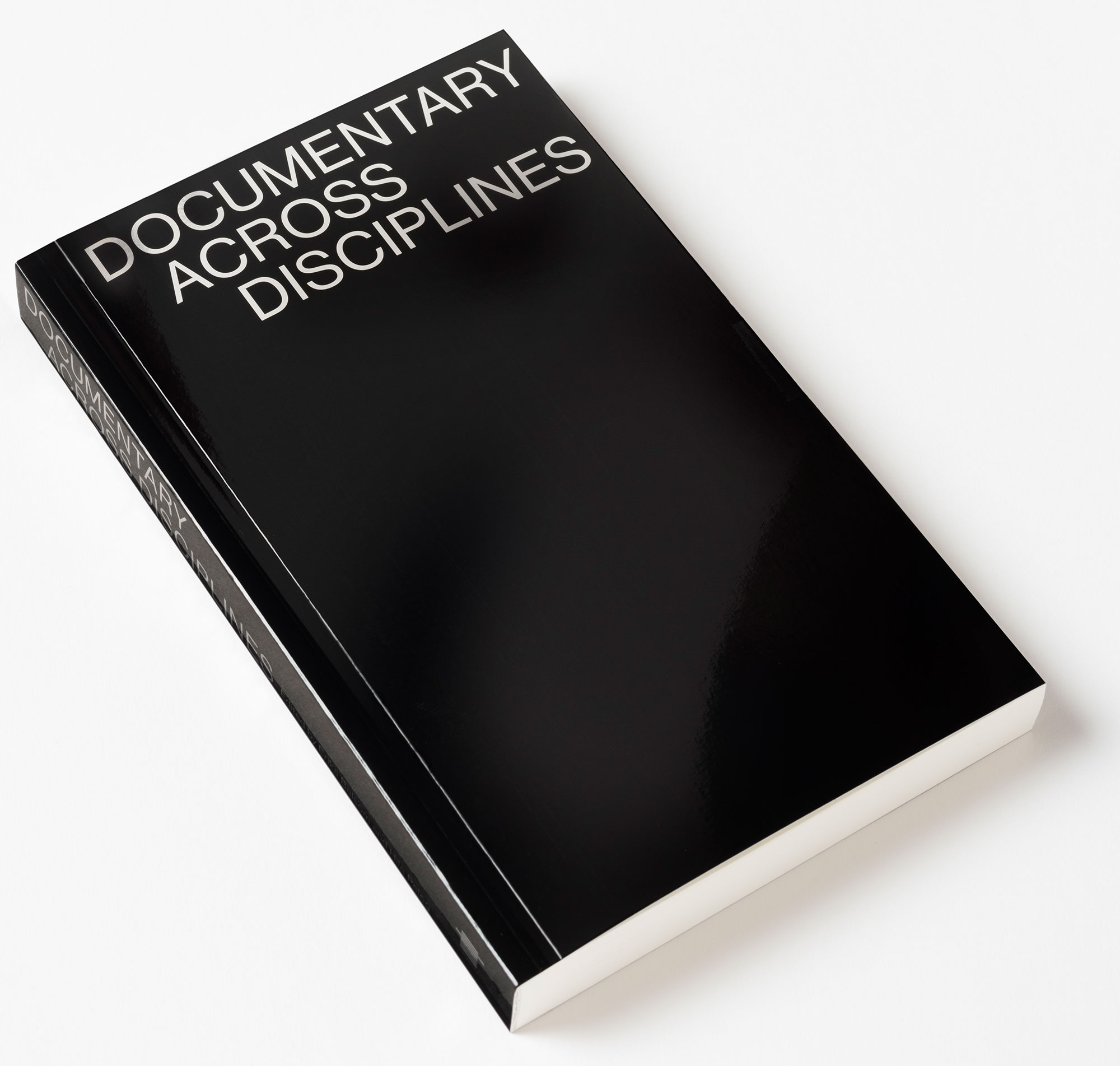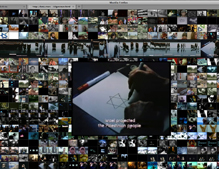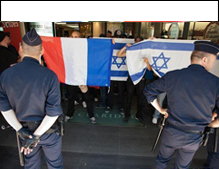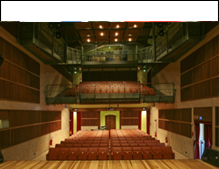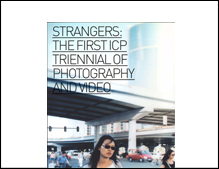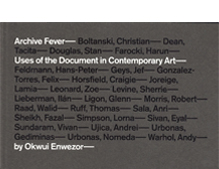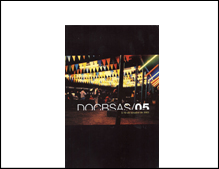-
Proposal for a visual media exhibition
with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -
Get my films
Buy DVDs online at www.momento-films.com -
IZKOR
slaves of memory
Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -
Common Archive Palestine 1948
web based cross-reference archive and production platform
www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -
Montage Interdit [forbidden editing]
With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -
Route 181
fragments of a journay in Palestine-Israel
Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST
-
The Specialist
portrait of a modern criminal
Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -
Jaffa
the orange's clockwork
Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST
-
Montage Interdit
www.montageinterdit.net
Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress
-
Common State
potential conversation [1]
Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -
Towards a common archive
testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine
Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013
-
I Love You All
Aus Liebe Zum Volk
Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST
publications
UN ÉTRANGER D’ICI par Eyal Sivan
De l'autre côté Nº1 2002Au mois d’octobre, j’ai commencé à enseigner « Ethique et cinéma » à l’Académie Sapir dans le Néguev, à quelques centaines de mètres de la ville de Sderot et de la barrière qui longe la bande de Gaza.
À la demande de mon ami Frank Eskenazi, rédacteur en chef de De L’Autre Côté, j’ai accepté une expérience inédite pour moi : écrire une chronique, pendant cette année d’enseignement en Israël.
Une chronique, pour quelqu’un comme moi qui pratique professionnellement l’observation et l’analyse de l’observation, est une expérience qui s’apparente à la description d’une série de plans, de scènes, de situations, parfois une image, une bribe de dialogue, des personnages… Les fragments proposés ici sont comme des repérages avant un tournage. Plutôt qu’une chronique, ce sont des notes de travail.
***
À l’aéroport de Roissy, j’attends l’embarquement en lisant Le Monde. Raffarin est favorable à la suppression de la chaîne de télévision libanaise Al Mahnar. L’éditorial du Monde va dans le même sens. Le portrait du jour est celui d’André Glucksmann. Il y a aussi un grand papier contre Tarek Ramadan. Dans les pages Économie, on apprend qu’Edouard de Rothschild propose de reprendre 37% du capital de Libé.
Je pars vers Tel-Aviv, mais c’est comme si j’y étais déjà.
Décidément, Israël est un pays d’avant-garde.
Au débarquement des avions qui atterrissent à Tel-Aviv, se trouvent des jeunes dont la fonction est de scruter les passagers. Ils regardent qui n’est pas Israélien, ou plutôt qui est Arabe. Je me demande si, pendant leur stage de formation, on leur a montré des photos pour s’entraîner et si on leur a fait écouter des enregistrements pour déceler les accents. Ils sont une forme archaïque de bio surveillance. Des machines sauront bientôt faire le même travail. Je suis sûr que certains travaillent déjà à les inventer. C’est un marché d’avenir.
***
Je râle contre les embouteillages à l’entrée de Jérusalem. Le chauffeur de taxi me calme : « On est sorti d’Egypte, on sortira bien de cet embouteillage ».
***
Partout, des slogans et des panneaux dénoncent le projet d’évacuation des colons de la Bande de Gaza : « Gush Katif, nous avons de l’amour », « Plus jamais ça », « Non à l’expulsion », « Le transfert ne passera pas », « Sharon déchire le peuple », « les Juifs n’expulsent pas des Juifs »,…
Comme l’avait remarqué le journal en ligne Rive Gauche (le 15 octobre 2004) : « Si les Juifs n’expulsaient pas des Juifs, on se demande bien qui ils expulsent ».
Le long de la route qui conduit à la Knesset, de jeunes religieux portant des kippas brodées, un châle de prières sur le dos et une mitraillette à l’épaule, recueil de prière à la main, se livrent à la prière du matin près de leurs tentes. Ces jeunes arracheurs d’oliviers, harceleurs de Palestiniens, fiers colonisateurs, jeunes pionniers protégés par la police, protestent depuis plusieurs semaines contre le plan dit « de débranchement » (désengagement) de Sharon.
Décidément, la seule opposition active contre le gouvernement israélien, est celle de l’extrême-droite. Cette large opposition de la droite vis-à-vis d’agissements qui sont pourtant commis contre les Arabes depuis 56 ans a de quoi rendre jalouse la gauche israélienne qui n’a jamais réussi une telle mobilisation.
***
Dans le sous-sol du bâtiment de la Knesset, sur le plateau de la chaîne parlementaire, je défends Tali Fahima dont le procès pour intelligence avec l’ennemi en état de guerre, port d’arme illégal, pénétration en zone ennemie et soutien à organisation terroriste a commencé la veille.
Je me retrouve assis à côté de Ari Eldar, chef de file de l’extrême-droite du parti Union Nationale. Ici, même quand on est dans un face-à-face, on s’assoit côte à côte. Comme attendu, il n’a pas lu l’acte d’accusation contre Tali Fahima, mais il croit savoir qu’elle soutient des terroristes et représente un danger pour le peuple juif. Amie avec des Arabes, c’est une traîtresse. Tali Fahima, une jeune femme de 27 ans, travaillant dans un cabinet d’avocats, électrice du Likoud et n’appartenant à aucun groupe politique, est née dans une famille juive marocaine, dans la petite ville de Kyriat Gat. Après avoir lu une interview avec le « terroriste » Zaccaria Zbeidi, le très recherché dirigeant des Brigades des Martyrs d’Al-Adsa, à Jenine, elle est tombée par hasard sur le film Les enfants d’Arna, qui raconte l’histoire de Arna Mer-Khamis, une Juive anti-sioniste qui lors de la première Intifada avait ouvert un théâtre pour les enfants du camp de Jenine. Son fils, l’acteur Juliano Mer-Khamis lui a consacré un documentaire ainsi qu’aux garçons qui avaient suivi les cours de théâtre et dont la plupart sont aujourd’hui des hommes qui défendent le camp de Jenine.
Bouleversée, Tali Fahima a décidé d’aller à Jenine pour y poursuivre le projet de théâtre de Arna Mer-Khamis. En découvrant la réalité du camp et les ravages de la politique israélienne d’assassinats ciblés, elle s’est résolue à rester à Jenine comme bouclier humain à Zaccaria Zbeidi. Pour la forcer à quitter Jenine, l’armée israélienne a menacé de détruire le camp. Et, depuis le mois de septembre, Tali Fahima est emprisonnée, pour l’exemple semble-t-il. Comme un avertissement à tous ceux qui pourraient rappeler «Tu ne tueras point », surtout s’ils n’appartiennent à aucun groupe politique, s’ils votaient Likoud, s’ils habitaient dans les petites villes de développement et éventuellement s’ils sont orientaux et femmes. Tout ce qu’est Tali Fahima.
Lors de ce débat télévisé, je rappelle à Ari Eldar que beaucoup de traîtres dans l’histoire juive sont considérés aujourd’hui comme des héros.
***
Dans le bureau du Parti Balad, (le parti nationaliste des Palestiniens citoyens de l’Etat d’Israël, dont le dirigeant est Azmi Bishara), des grands portraits encadrés de Nelson Mandela sont soigneusement accrochés aux murs. Chez Hadash (ex-communistes), ce sont des photos d’Arafat, des drapeaux palestiniens et d’innombrables tracts dénonçant l’occupation qui tapissent les murs. Les petits bureaux de deux partis arabes se trouvent au niveau moins un de la Knesset.
***
Le chauffeur de taxi qui me conduit de Tel-Aviv à Jérusalem est un des enfants d’origine orientale qui a été séparé tout jeune de ses parents pour aller grandir dans un kibboutz. Ensemble, on parle du matzav (la situation).
« On leur a tout donné, dit-il (ça y est, on est on), quand j’étais soldat, j’ai vu des cartes en arabe sur lesquelles était dessinée toute la Palestine. Alors, tu vois bien qu’ils veulent tout. On peut pas discuter. Barak leur a tout donné. Il n’y aura jamais de paix ».
Je lui demande : Mais s’il y a la paix quand même ?
« S’il y a la paix… Alors, c’est sûr, on va s’entre-dévorer entre nous ! ».Petit à petit, il m’énumère tout ce qui, dans notre société, est susceptible de mener à la guerre civile : les religieux, les Russes, les gauchistes, les Arabes israéliens… Nul n’a grâce à ses yeux.
Tout en conduisant, il s’énerve : « T’as qu’à regarder l’histoire. Jamais personne n’a pu supporter les Juifs bien longtemps. C’est sûrement pas par hasard ! ».
Au fur et à mesure de notre voyage commun, ses propos deviennent de plus en plus antisémites.
***
Du balcon de l’appartement de Anat, une camarade de lycée, à Jérusalem Ouest, on découvre toute la ville de l’Est à l’Ouest. Quand le temps est clair, on voit même les montagnes du Jourdain. Maintenant, au bord du désert, on voit aussi le mur. Nous regardons la vue et elle me dit : « Quand j’ai vu le mur, je me suis dit que les Juifs étaient sortis du ghetto, mais qu’ils ne peuvent pas extraire le ghetto qu’ils ont à l’intérieur ».
***
Le mur a pour fonction de détourner l’attention de la colonisation. Il est consensuel. Personne ne l’aime, mais la plupart des Israéliens le considèrent comme indispensable.
***
Au fur et à mesure que l’apartheid se renforce, c’est la liberté des Blancs qui augmente.
***
Le lundi matin, je fais la route avec l’historien du judaïsme Amnon Raz Krakotzkin pour aller enseigner dans le sud du pays. On sort de Jérusalem, direction Bethléem, on traverse la colonie de Gilo, puis on se dirige vers Beit Jala. Des jeeps sont garées au bord de la route. Les unités mobiles de garde-frontières fouillent les véhicules des Palestiniens et vérifient leurs papiers d’identité. On passe le check point pour « re-entrer » en Israël.
Au passage, dans un rituel rôdé, on baisse la vitre de notre voiture et, avant qu’ils n’aient le temps de nous poser une question pour vérifier notre accent, on salue nos soldats en leur criant « Juifs ! Juifs ! ».
Rassurés, ils nous laissent passer. Quelle magnifique revanche sur l’histoire.
***
Au bord de la route, de gigantesques grillages. Derrière, une bourgade palestinienne. Parfois, le grillage s’arrête et un paysage inhabité apparaît puis un village, entouré de barbelés. En arrivant à Beit Gouvrin, les villages palestiniens ne sont plus entourés de barbelés. Il n’y a plus que des ruines. Ils ont été vidés en 1948 et détruits par la société archéologique d’Israël dans les années 1960. Beit Gouvrin est maintenant un site de fouilles archéologiques. Les archéologues s’activent à dévoiler des vestiges hellénistes.
***
Dans le Néguev, entre les petites villes, villages et kibboutz, les gens font de l’auto-stop. Je fais du stop à mon tour pour arriver à l’Académie Sapir, face à la ville de Sderot. C’est aussi la route qui mène vers la Bande de Gaza et à ses colonies.
Un colon de Gush Etzion, près d’Hébron, arrête sa voiture. Je monte.
« Sharon ne comprend pas. Soit quelque chose ne va pas dans sa tête, soit il subit de grandes pressions ».
Il prie pour que les colonies de la Bande de Gaza ne soient pas évacuées et semble rassuré parce que, chez eux, dans les colonies près d'Hébron, on ne cesse pas de construire et que la demande est forte.
« Et en plus, les juifs français arrivent » me dit-il.
***
Je prends un taxi dont le chauffeur est un Juif religieux : « J’ai travaillé avec les ouvriers, à Gaza. J’allais chez eux. Ils servaient les repas dans de grands plateaux métalliques. Et, crois-moi, les légumes des salades étaient bien coupés. Et quelles salades ! Sans parler des kebabs ! C’est sûr, mon frère, on peut vivre ensemble. Je me fous de qui est le voisin, s’il me laisse vivre tranquille. Tout est affaire d’argent. » ( Il n’est pas marxiste ) « Tu vois ces enfants dans la rue ? (nous sommes à Salame, quartier palestinien qui séparait Tel-Aviv de Jaffa avant 1948) Pourquoi leurs mères devraient avoir peur pour eux ? ».
Je lui réponds que les mères à Gaza aussi s’inquiètent pour leurs enfants.
Il réagit immédiatement : « Bien sûr ! Elles s’inquiètent bien plus ! Ils sont en plus grand danger »
***
Un collègue d’université, professeur de films d’animation, a sa théorie sur l’ambiance générale: « Dans ce pays, chacun a l’impression de s’être fait avoir, du fait même qu’il est venu ici ou qu’il est né ici. Et puisque tout le monde s’en rend compte, tout le monde refuse de se faire avoir à nouveau. On est en permanence sur la défensive et c’est seulement en abusant les autres qu’on a l’impression de se faire un peu moins avoir ».
***
Dans la gare centrale de Tel-Aviv, un aveugle descend d’un taxi pour en prendre un autre et rentrer chez lui, à Jaffa. Un des chauffeurs le reconnaît, il a l’habitude de le ramener chez lui.
Il crie vers l’aveugle : « Salut Shlomo, ça va »
L’aveugle lui répond : « C’est toi, Haïm ? Comment ça va ? ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu »
Ici tout le monde est clairvoyant, tout le monde est ami.
***
Quand on constate le fait accompli dans les territoires occupés, la construction des colonies, les routes, les panneaux publicitaires des projets immobiliers et qu’on se rappelle que plus de la moitié a été construite ces dix dernières années, on se dit qu’il faut inventer une forme de résistance inédite car le régime qui se développe ici n’a pas encore de nom.
C’est un étrange mélange de dictature militaire, de ségrégation, avec une dose de régime carcéral et un peu de culture du ghetto. Une ségrégation entre privilégiés, colons et fonctionnaires du processus de paix en tout genre et les autres.
***
En voiture avec mon ami Dan, nous quittons Tel-Aviv. Pour aller jusque chez lui, il faut prendre la route qui relie le centre du pays aux grands blocs de colonies. Les colonies des territoires s’étendent jusqu’au dernier quartier sur la ligne verte. À droite de la route, un mémorial de fortune a été dressé en souvenir d’un colon qui a été tué.
Dan m’explique ce qu’est la perversité. « On refuse l’annexion des territoires, mais on refuse de s’en séparer. On les accuse de ne pas être démocrate et on leur refuse la liberté. On les tue et on n’en est pas fiers. Nous sommes des bourreaux, mais nous nous considérons comme des victimes. Pas comme les Allemands. Eux, ils haïssaient les Juifs et ils les exterminaient. Nous on hait les Arabes et on les enferme. On est des judéo nazis ». Dan, directeur du marketing dans une société de high-tech, est le fils unique de deux rescapés roumains des camps de concentration nazis. Ceux qui, en France, m’accusent de parti pris ou d’extrémisme, devraient venir plus souvent, chez moi, en Israël.
Nous pénétrons dans le beau quartier résidentiel où il vit avec sa famille : petites villas avec jardin et parking privé. « Tu vois, me dit Dan en montrant les maisons de ses voisins, il n’y a personne ici à qui je puisse dire que nous sommes des judéo nazis ».
Je me dis qu’il faut vite trouver un nom à ce mode politique nouveau, à cette structure politique, à ce régime. Peut-être la perversocratie.
***
La classe moyenne juive israélienne survit économiquement dans ces belles maisons, avec deux voitures et une terrible dette bancaire.
***
Une soirée chez des amis. Nous avons tous la quarantaine. Quatre hommes, cinq femmes, trois couples, tous divorcés après des années de séparation et de guerre. Chez nous, la séparation est à la mode.
En quittant la soirée, il faut traverser un barrage à la sortie du quartier. Ralentir, baisser la vitre, lancer un bonsoir poli pour signaler qu’on est juifs. Car ici, on distingue les Juifs des autres. Le Juif peut passer le barrage, il peut sortir. C’est peut-être ça aussi le rêve sioniste : pouvoir sortir du ghetto que l’on s’est construit sur mesure en ayant comme seul laisser passer le fait d’être juif.
Le sionisme serait donc le mouvement national juif de revanche sur le monde. Le monde s’en fout, car cette revanche sur le monde se fait sur le dos des Palestiniens. Pas de chance.
***
Je me rends à uneréception donnée par la nouvelle revue Mitaam, revue de « poésie, littérature et pensée radicale » éditée par le critique littéraire Yitzhak Laor, à Tel-Aviv. Le débat porte sur « culture et politique » et accueille entre autres Nuri th Elhanan Peled, professeur à l’école d’éducation, qui a perdu sa fille dans un attentat-suicide à Jérusalem. Elle explique qu’on ne pourra pas changer la perception que les Israéliens ont des Palestiniens sans changer les manuels scolaires. Elle cite quelques exemples tirés du nouveau manuel de l’après-réforme. Plusieurs manuels scolaires dits « post-sionistes », dans lesquels l’historien (ex-ambassadeur d’Israël en France) Elie Barnavi a notamment écrit :
Dans le livre XXe siècle :
Chapitre 32 : Les Palestiniens, des réfugiés à une nation. Ce chapitre traitera de l’évolution du problème palestinien (…) et les approches du public israélien face à ce problème et aux moyens de le résoudre.
L’opération Kadesh(la guerre de 1956) a marqué un tournant en faveur des Arabes d’Israël. Elle a certes commencé avec la tragédie de Kafer Kasem, mais, à long terme, la victoire écrasante, le calme relatif le long des frontières et la confiance en soi de la population juive ont transformé le régime militaire (imposé aux Arabes d’Israël)en un poids moral et politique insoutenable. Dix ans plus tard, il a été totalement annulé.
Page 258 : L’assassinat de Rabin est l’expression tragique de l’apparition d’un fondamentalisme juif qui n’est pas différent du fondamentalisme musulman.
Dans le livre Temps Modernes :
Page 238 : Les Palestiniens ont basé leur identité sur leur rêve d’un retour en Eretz Israël (…) C’est dans la misère, dans l’indigence et dans la frustration qui étaient le pain quotidien des réfugiés dans leurs pitoyables camps, qu’a mûri le ’problème palestinien’.
Page 239 : Pendant plus d’une génération, le problème palestinien a empoisonné les relations (d’Israël) avec le monde arabe et la communauté internationale.
Page 228 : Le massacre de Deir Yassin reste une tâche dans l’histoire du combat juif pour la survie et l’indépendance. Dans le domaine politique, il a servi comme un élément central dans la propagande arabe contre Israël. Son influence a pu être mesurée à court terme : il n’a pas entamé la fuite massive des Arabes du pays qui avait commencé avant, mais les informations sur le massacre l’ont beaucoup accéléré.
Page 230 : La fuite des Arabes a résolu, au moins partiellement, un problème démographique monstrueux. Même un homme modéré comme Haïm Weizman en a parlé comme d’un miracle.
Au cours de cette soirée, Amnon Raz Krakotzkin se demande pourquoi des gens qui défendent des idées du XVIIIe siècle de « citoyenneté, égalité et fraternité » se sentent obligés de signaler sur la couverture de leur revue qu’ils sont radicaux.
« En quoi sommes-nous radicaux ?, demande Amnon. Nous serions radicaux si nous acceptions de débattre du droit au retour et de la lutte contre la séparation »
« Nous avons écrit "radical" sur la revue, lui répond Itzhak Laor, parce que c’est une revue de poésie, de littérature et de pensée politique non sionistes ».
J’apprends qu’en hébreu, « non sionistes » ça se dit « radical ».
***
L’éditrice Ilana Hammerman défend l’intérêt d’éditer des témoignages personnels sur la montée du nazisme et des Allemands qui ont vécu cette période : « C’est important pour essayer de réveiller un peu les gens ici. »
Je pense à ce que disait le philosophe Adi Ofir à propos des analogies entre l’Allemagne nazie et Israël, lors de sa présentation du premier essai sur Hannah Arendt édité en hébreu : « Bien sûr qu’on ne compare pas, car rien n’est comparable. Pourtant, on ne fait que comparer en permanence, tout en précisant que, bien sûr, ce n’est pas comparable ».
***
Dans un nouveau livre intitulé Colonialisme et situation post-coloniale, le sociologue Yehuda Shenhav défend la selon laquelle l’occupation se retournerait contre des habitants de l’intérieur du pays. En attendant, le régime d’occupation se retourne en tout cas contre les Orientaux en Israël.
Il suffit de comparer deux conseils régionaux adjacents dans le sud du pays, celui de la ville de Dimona (petite ville de développement construite dans les années 1960 pour accueillir les Juifs du Maghreb) et celui de Tamar (le moins peuplé du pays sur lequel sont implantés quelques kibboutz).
Mille fois moins d’habitants, mille fois plus de taxes locales. Le très secret Centre de recherches nucléaires qui se trouve à la sortie de la ville de Dimona paie ses taxes locales au conseil régional de Tamar, comme toutes les stations d’essence de la région et toutes les usines qui entourent la ville de Dimona, une des plus pauvres du pays. Pas clair précise
« L’Etat-providence le plus développé au monde existe en Israël, conclue Shenhav, il attribue des budgets, de l’aide sociale, des logements, du travail et de la sécurité ».
L’Etat-providence est réservé aux colons dans les territoires occupés.
***
Ce soir, je suis invité à dîner chez des amis palestiniens à Beit Hanina, pas loin de la « colline française ». Mais à Jérusalem, il est bien difficile de trouver un chauffeur de taxi qui accepte de vous conduire dans un quartier arabe.
Le premier taxi que j’arrête refuse de m’emmener.
Je monte dans un deuxième sans dire un mot. Après qu’il a démarré, je lui précise ma destination. Le chauffeur me répond qu’il ne va pas chez les Arabes.
J’essaie de le convaincre : « Mais c’est Jérusalem, quand même ! ».
L’argument ne tient pas. « Je vous dis que je ne vais pas dans la casbah. J’ai peur ».
Notons que les Arabes vivent toujours dans une casbah…et visiblement, c’est l’équivalent d’un nid d’abeilles ou d’un panier de serpents.
Comme je commence à engueuler le chauffeur, il me répond simplement : « Je n’irai pas. J’ai peur ».
Je comprends que les arabes aient peur, mais je ne comprends pas de quoi lui, il peut avoir peur. Je descends du taxi.
Je parie que ces deux chauffeurs de taxi sont pour la Grande Jérusalem et contre sa division. Je me dis que Maya, qui travaille au Centre d’Aide Juridique des Ouvriers Palestiniens, a bien raison. Elle définit l’israélité comme une « dissonance cognitive ».
***
Rahat, est une ville du Néguev, dans laquelle les habitants, tous bédouins, ont été contraints à la sédentarisation. Le taux de chômage est le plus élevé du pays, la délinquance est effroyable, les drogues circulent, les structures politico-religieuses s’imposent facilement à la population … La mairie est en faillite. La situation m’évoque ce que j’imagine des réserves indiennes.
Je viens à Rahat pour participer à une réunion sur les questions d’éducation, à laquelle assistent quelques notables, ainsi que des militants politiques et associatifs. Notre objectif est de proposer la création d’ateliers de cinéma pour les jeunes de la ville et de les aider à obtenir les bourses nécessaires pour suivre les cours en université.
Mais l’ambiance est désabusée, trop de promesses n’ont pas été tenues, trop de « nécessités fonctionnelles » étouffent les initiatives. Il semble difficile de convaincre les habitants de Rahat de l’importance de l’expression cinématographique, eux qui aspirent pour leurs enfants aux métiers dont rêvent tous les immigrés du monde : médecin, avocat …
C’est un peu comme le shtetl. Comme jadis les Juifs européens orientaux, ces Arabes sont des immigrés dans leur propre pays.
***
En voiture avec ma mère. Nous allons faire des courses dans l’immense et toute récente zone commerciale de Jérusalem, installée dans d’anciens garages.
L’autoradio diffuse les informations du jour : morts à Gaza, destructions de maisons à Naplouse, arrestations de suspects, disparitions, …
Ma mère soupire : « Je ne peux plus supporter ça ». Elle tourne le bouton à la recherche d’une autre station et trouve enfin ce qu’elle cherche : une émission culturelle sur Wagner et le romantisme.
***
Je me promène dans Tel-Aviv, vendredi soir, rue Allenby. Des jeunes de 18-25 ans marchent en couple ou en groupe. La plupart sont en permission militaire. Beaucoup parlent russe entre eux. Les portes d’entrée des boîtes de nuit sont gardées par de gigantesques videurs, caricatures d’Ukrainiens sculpturaux.
Des dizaines de jeunes Israéliens - des garçons au crâne rasé, les pectoraux moulés dans des ticheurtes foncés et des filles en minijupe, aux décolletés et aux maquillages provocants, font la queue devant les barrages de sécurité dressés devant les boîtes de nuit. Vérifications d’identité. Fouilles de sacs à main.
Une fois par semaine, les jeunes Israéliens sont de l’autre côté des barrages, mais eux c’est pour aller draguer, boire et danser en boîte de nuit.
***
J’assiste au colloque Esthétique et violence organisé par la Haute Ecole de Communication de l’Académie de Management de Tel-Aviv. On parle de post-modernisme, de Tarantino, du rabbin raciste Kahana (mort il y a plus de dix ans)… Comme si « Esthétique et violence » n’était qu’un pur concept académique, sans rapport avec le quotidien de notre pays.
***
Jérusalem ouest. Je cherche un taxi qui accepte de me conduire à l’hôtel Ambassador, à Jérusalem Est, où j’ai un rendez-vous.
Plusieurs chauffeurs ont fermement refusé.
Je finis par en trouver un dont le chauffeur, Palestinien, accepte de me prendre. Il me donne un truc : la prochaine fois que je devrais me rendre à l’hôtel Ambasador en taxi, il suffit de demander au chauffeur de me conduire au Quartier Général de la Police Israélienne de Jérusalem, ils accepteront sans problème : les deux bâtiments se font face dans la même rue.
Les Palestiniens connaissent si bien la société israélienne que, lorsqu’on monte dans un taxi conduit par un chauffeur palestinien, il imite l’accent israélien pour éviter que certains clients redescendent immédiatement de sa voiture. La peur, sans nul doute.
***
Je suis en voiture avec Amira Hass, la correspondante du journal Ha’artez dans les Territoires Occupés. Nous allons de Jérusalem à Ramallah, où elle vit.
En principe, sa carte de presse lui permet de franchir les barrages militaires. Mais en voiture, elle doit utiliser le passage réservé aux privilégiés (journalistes, diplomates, ONG, membres de l’Autorité Palestinienne détenteurs de cartes VIP ou d’autres laisser passer spéciaux). En tant que citoyens israéliens, il nous est interdit de pénétrer dans Ramallah. Amira connaît les astuces. Nous empruntons les routes dites juives (c'est-à-dire celles qui mènent aux colonies) pour contourner Ramallah sur plus de 20 kilomètres et accéder à un passage qui n’est ni barré ni contrôlé. Amir est hantée par sa réflexion sur les limites entre la résistance et la collaboration, qui permet l’occupation. Elle ne cesse de penser et de réinventer la résistance.
***
À l’université de Sderot, un de mes cours est consacré au dilemme éthique dans le cinéma documentaire. À chaque début de cours, je dois faire l’appel car l’assiduité compte pour l’évaluation des étudiants. Le règlement précise que chaque absence doit être justifiée. Un de mes élèves me présente un document militaire expliquant qu’il était en service de réserve la semaine passée. Je lui demande où il était. « À Gaza ». Puisque le règlement accepte de telles justifications, je décide que n’importe quelle autre raison pourra dès lors excuser une absence de mes étudiants.
***
L’un d’entre eux est officier à l’armée. Ses façons d’être et de parler trahissent son statut militaire. Quand il faut ranger la classe, par exemple, il prend spontanément la direction des opérations et les autres lui obéissent facilement. C’est vrai qu’il est efficace.
Parfois, pendant les cours, la sirène municipale de Sderot sonne l’alerte générale annonçant un tir de missile Kassam en provenance de la Bande de Gaza. Presque à chaque fois, il déclare d’un ton fort et rassurant : « Ne vous inquiétez pas. Ce n’est rien ».
Il a commandé une unité militaire pendant l’invasion de Jenine et pendant la destruction de Rafah.
Il suit mes cours d’éthique.
Après qu’un des professeurs de l’université, un professeur palestinien, l’a traité de criminel de guerre, il a voulu m’expliquer sa position : « Si je vais me battre là-bas, c’est parce que ce qui est le plus précieux à mes yeux, c’est la vie humaine. Avec ces valeurs-là, je peux épargner des vies humaines, israéliennes et palestiniennes ».
Dans son mémoire, il a l’intention de me convaincre qu’on peut changer le système de l’intérieur, être contre l’occupation comme lui et combattre dans les territoires occupés. Mais il pense qu’il n’aura probablement pas assez de temps pour le rédiger avant la fin de l’année.
***
Dans l’hébreu d’aujourd’hui, on utilise fréquemment la formule kav adom, la « ligne rouge «», pour définir les limites à ne pas dépasser.
Cette ligne rouge marque les frontières éthiques au-delà desquelles il serait immoral d’aller. L’usage immodéré de cette formule à propos de petites et de grandes choses, en particulier au sujet de la répression dans les territoires occupés, conforte la société israélienne dans sa certitude de rester vertueuse.
Pourtant, en deçà de cette ligne rouge, s’accumulent quotidiennement des actes qui vont du blanc rosé au rouge clair, mais dont on peut se réjouir qu’ils ne franchissent jamais la limite kav adom…
***
Parmi mes étudiants, il y a deux garçons originaires d’Ukraine. Ils sont absolument silencieux et je crois même qu’ils ne maîtrisent pas vraiment l’hébreu.
Un autre Ukrainien est plutôt bavard. Il essaie de me piéger en me bombardant de questions. Je lui réponds, sans me fatiguer. Ses observations trahissent un esprit formaté sur le moule « eux/nous ». Sur le cinéma qu’il veut faire, il a son idée aussi : « En Ukraine, on me traitait de juif. Ici, on me traite de russe. Mais moi, ce que je veux, c’est montrer ce qui est beau ».
***
Le directeur du département Cinéma et Culture de la faculté est d’origine brésilienne. Il est né en Israël dans un kibboutz de Brésiliens, spécialisé dans les groupes de samba et construit sur les ruines d’un village palestinien de Brir dont les anciens habitants se sont réfugiés à quelques kilomètres, dans la Bande de Gaza. Il prépare un film sur les relations d’amitié entre les pêcheurs israéliens et palestiniens, sur une terre isolée de la côte de Gaza.
Il voudrait créer une école radicale pour un cinéma radical, encourage les étudiants bédouins à venir étudier à Sderot et rêve de tisser des liens avec les habitants de la Bande de Gaza si proche.
Mais en attendant, l’administration considère que sans doctorat, il ne peut pas continuer à diriger le département. L’année prochaine, il est envoyé à Londres pour se consacrer à sa thèse. Il y a des priorités.
***
L’administrateur chargé des étudiants à l’université est responsable des attributions de bourses. Ancien militaire de carrière, il a quitté l’armée pour étudier et passer un doctorat. Mais il a finalement décidé d’enseigner l’histoire dans un lycée à Ofakim, une petite ville de développement, dans le Néguev, principalement habitée par des Juifs maghrébins. Depuis quatre ans, il travaille à Sderot. Il est convaincu que la seule issue pour notre pays, c’est la révolution et qu’elle viendra du Néguev, car ce sera une révolution sociale.
Il n’est pas gauchiste, c’est un administrateur sérieux.
***
Entre deux cours, une de mes étudiantes me fait part de ses inquiétudes : elle craint que les exemples politiques que je cite pour illustrer mes cours gênent certains de ses camarades. Ce qui n’est pas son cas, bien sûr, car elle est de gauche, me précise-t-elle. Mais elle préfèrerait quand même que mon propos soit moins politique.
Pourtant, faire de la politique, c’est aussi briser cette paisible normalité universitaire et rappeler que le documentaire doit s’ancrer dans le présent.
***
9 janvier 2005. Jour de l’élection du Président de l’autorité palestinienne. Devant le bureau de vote, à l’entrée de la vieille ville de Jérusalem, les observateurs internationaux et les journalistes sont plus nombreux que les votants.
Les commerçants regardent les observateurs internationaux, qui regardent les journalistes, qui regardent les employés du poste mobile de bureau de vote, qui regardent leur montre en attendant la fin de cette interminable journée.
Un ami palestinien (commerçant, fils de commerçant et collectionneur de broderies anciennes, dans le vieux marché de Jérusalem) me confirme le faible taux de participation : « On est palestinien. On a la carte d’identité bleue (israélienne). Mais si on va voter, demain on sera convoqué par le Shabak (Service israélien de la Sécurité Intérieure) et soupçonné de manque de loyauté. Crois-moi, il vaut mieux éviter les problèmes, pour soi et pour sa famille. Sinon on risque de ne pas avoir de passeports pour partir en vacances ou, pire, de ne pas pouvoir revenir de vacances ».
***
L’aéroport Ben Gourion 2000 de Tel-Aviv est flambant neuf. Toutes les inscriptions sont en hébreu et en anglais. L’arabe est pourtant la deuxième langue officielle du pays. Mais dans tout l’aéroport, il y a un seul mot en arabe : douanes. C’est peut-être pour que les Arabes ne se sentent pas dépaysés, ici aussi il y a un barrage.
Ben Gourion 2000 a deux atouts : son service de sécurité réputé inviolable et sa zone commerciale, construite sur le modèle des plus grands centres commerciaux du pays. Fonctionnant comme un microcosme, cet aéroport est une vitrine alléchante de la société israélienne : consommation et sécurité.